|
|
« Notre
vie est expérimentation, exploration ».
Marilyn Ferguson.
Si
mon parcours professionnel mérite d'être évoqué, ce n'est pas en
raison de son exemplarité, mais parce qu'il me semble illustrer, à
sa manière,
la condition enseignante actuelle et
qu'il pourrait peut-être aider des enseignants qui se posent la
question du sens de leur pratique,
leur évitant dans certains cas de succomber aux diverses formes que
peut prendre le découragement chez les enseignants, malaise
enseignant
et burn-out.
Comment
suis-je devenu professeur ?
C'est
la question que je me pose parfois, au terme de trente-sept années
d'enseignement, effectuées au lycée. Referais-je aujourd'hui ce
même choix professionnel ? À cette question, je répondrais sans
hésiter par l'affirmative. Pourtant les difficultés et les moments
de découragement et d'angoisse ne me furent pas épargnés, tout
comme à de nombreux collègues.
Partons
du début. Je fus recruté, comme la plupart de mes collègues, sur
la base d'un amour certain et d'une bonne connaissance de la matière
que j'ai enseignée, l'espagnol. La littérature hispano-américaine,
telle était ma spécialité. La rencontre d'un enseignant
martiniquais, au cours de ma scolarité, (c'était en classe de
première) fut décisive. J'étais de
gauche et
passionné par l'Amérique-Latine. Je voulais échapper au monde de
l'entreprise et de l'administration, ainsi qu'au voisinage d'adultes
que je percevais comme ennuyeux et dotés d'esprit de sérieux.
Je
fus reçu à l'agrégation en 1974 et parachuté dans une ZUP de la
banlieue parisienne, sans aucune formation, tant sur le plan
didactique, que sur le plan psychopédagogique. Confronté d'emblée
à des classes difficiles, des
classes interculturelles d'une
grande diversité sur le plan social, culturel et ethnique surtout,
je fus amené, de manière spontanée, à réfléchir à la pédagogie
interculturelle. C'était presque une question de survie, ou, en tout
cas, d'efficacité pédagogique. Mes recherches eurent dès le début
un aspect résolument pragmatique. Si
j'entrepris d'abord des lectures et une réflexion dans le domaine de
la pédagogie interculturelle, ce fut
pour faire face aux problèmes que me posait la gestion de ces
classes difficiles, pour tenter de comprendre ce que je vivais en
classe, pour ne pas perdre pied et pour trouver des éléments de
réponse aux questions que me posait ma pratique enseignante, en
l'absence de toute aide extérieure. C'est alors que j'écrivis mon
premier article qui parut dans une revue de l'INRP (Institut National
de Recherche Pédagogique) grâce à l'intervention d'une inspectrice
du primaire, qui était aussi chercheur et formatrice. Il
s'intitulait Une
expérience de pédagogie interculturelle : prolongements sur le plan
de la formation et valeur thérapeutique.
Dans
ce premier travail, lequel fut suivi d'une trentaine d'articles , je
développais l'idée, découverte sur le tas et confortée par des
lectures, que le fait de faire cours pouvait posséder des vertus à
la fois formatrices et thérapeutiques. Thérapeutiques,
oui, car je fis aussi dans ma chair l'expérience qu'il pouvait être
dangereux d'enseigner dans le contexte actuel et qu'il
fallait se prémunir contre le stress et l'angoisse, tout en aidant
les élèves à gérer leurs propres difficultés, idées
que je retrouvais développées par des chercheurs et des thérapeutes
en charge d'enseignants en difficultés parfois graves et exerçant
leur action thérapeutique et aidante au sein des services de la
Mutuelle générale de l'Éducation nationale (M.G.E.N.). Ada
Abraham, spécialiste de l'étude du vécu
intérieur des enseignants et
animée d'un regard positif et empathique sur le travail de
professeur, m'aida à la fois à comprendre les différents enjeux et
à résister.
Je
me suis mis aussi à rédiger des
journaux professionnels,
où
je consignais, au jour le jour, mes expériences en classe et mes
difficultés.
C'est Philippe Perrenoud, je crois, qui, le premier, m'aida à
comprendre que la tenue d'un journal possède des vertus
thérapeutiques ou cathartiques, en ce qu'il permet de revenir, à
tête reposée, et avec du recul, sur des évènements vécus en
classe avec une forte implication affective
et émotionnelle.
À
la faveur de ce travail d'écriture et à l'abréaction qu'il
favorisait, je compris qu'il me fallait mettre en place, avec mes
élèves, des rapports justes et équilibrés, des rapports, faits
certes de compréhension et d'empathie,
mais qui ne soient pas fusionnels, ce qui
était alors un risque pour moi, étant donné mon fonctionnement à
l'époque. La
non-directivité rogérienne était,
je le compris, un écueil pour des personnes ayant des difficultés à
assumer un rôle normal d'autorité et se réfugiant derrière la
théorie rogérienne en la détournant de son sens premier, à des
fins individuelles.
Faut-il
être sincère et honnête dans l'évocation rapide de ce parcours,
évocation dont le but n'est pas de me donner en spectacle, ni de
proposer mes expériences comme exemplaires et généralisables à
tous ? C'est en tout cas, en toute conscience, que je dirai ici que
les avatars de mon histoire personnelle et le fait que j'aie suivi un
travail analytique jungien, a joué un rôle certain dans ma manière
d'enseigner, de gérer les conflits en classe, et de négocier les
sentiments d'angoisse et d'incertitude, qui ne manquèrent pas de
m'assaillir, tout au long de ma carrière, sans que cela ne m'empêche
de connaître le plaisir et la joie d'enseigner, tout comme mon
collègue Bernard Defrance et d'autres.
La
découverte de Carl Rogers fut décisive.
Je
m'aperçus, en lisant Liberté
pour apprendre ?
et Le
développement de la personne
que j'étais rogérien sans le savoir. Ce sentiment était source de
réassurance et d'encouragement à poursuivre dans la voie que je
suivais depuis quelque temps déjà, de manière un peu isolée, et
en tâtonnant. Carl Rogers et Carl Gustav Jung, les deux Carl
que j'entrepris de lire et de méditer, m'aidèrent à comprendre que
le fait d'enseigner pouvait faciliter un
développement personnel
et que les deux questions du sens de ma pratique professionnelle et
du sens de ma vie, étaient liées de façon assez étroite.
Bruno
Bettelheim écrit que, dans certaines situations difficiles, l'homme
ne peut survivre
qu'en s'engageant sur la voie d'un développement personnel et d'une
maturation plus grande. Ce constat établi par le psychologue
américain, sur la base de son expérience dans les camps de
concentration,
pouvait, me semblait-t-il, être transposé sur le plan de
l'expérience enseignante, même si, naturellement, il existe une
différence de degré et d'intensité entre ces deux expériences
vitales.
Une
autre fois, je me souviens, je sortis découragé d'un conseil de
classe de seconde, où de nombreux redoublements avaient été
décidés. C'est alors que j'écrivis un article intitulé Projet
d'aide méthodologique en classe de seconde,
comme pour dépasser un sentiment passager de découragement et ne
pas rester sur une impression négative d'échec et de culpabilité.
Mes déboires avec l'inspection faillirent, eux aussi, me
déstabiliser, au moins de manière provisoire, mais la
tenue d'un journal et la rédaction d'un livre qui ne vit jamais le
jour et que j'intitulai L'inspection
: histoire d'un exorcisme et critique d'une institution,
m'aida à résister. Un peu plus tard, Guy Avanzini, alors directeur
des Cahiers
Binet-Simon,
me confia la coordination d'un numéro spécial sur l'inspection, ce
qui me permit de prendre définitivement mes distances par rapport à
cette institution, empêchant qu'elle ne me nuise et nuise aussi au
caractère vivant et spontané de la relation que je tentais
d'entretenir avec mes élèves. Cet épisode m'aida, dans le même
temps, à retravailler la
question du père,
selon le principe énoncé par Marilyn Ferguson et qui veut que, dans
le nouveau paradigme anthropologique en train de naître,
il n'existe ni échec ni réussite et pas d'ennemis, mais seulement
des personnes qui, à cause de leur propre fonctionnement, nous
permettent d'éclairer nos faiblesses, nos failles, nos blessures,
comme le ferait un miroir grossissant. L'inspection me permit de
travailler
l'image du père, que je nourrissais en moi et d'éclaircir mes
rapports à l'autorité, avec mes élèves et avec mes supérieurs
hiérarchiques. Les
divers journaux que je rédigeai pour comprendre les conflits et les
crises en classe, s'ils ne furent pas publiés, servirent de
matériaux à mes livres et à mes articles
et j'y associai, un moment, mes propres élèves auxquels je
demandais de me communiquer, par écrit, leur témoignage sur mon
enseignement et sur la manière dont ils percevaient nos relations.
Car,
je me mis, en effet, à écrire des articles et des ouvrages plus
théoriques, avec toujours le même souci
de comprendre mon vécu en classe, guidé
par l'idée que la maîtrise intellectuelle, ou plutôt émotionnelle,
de mes difficultés, était ce qui en faciliterait la résolution.
Ayant reçu un certain nombre de blessures narcissiques de la part de
l'Institution (problèmes avec certains élèves, avec leurs parents
et avec les inspecteurs),
j'avais, de manière normale, il me semble, besoin d'un peu de
reconnaissance et d'encouragement. Et le fait que certains chercheurs
en sciences de l'éducation répondent à mes courriers et m'ouvrent
les colonnes de leurs revues, mérite d'être signaler comme preuve
de ma reconnaissance. Guy Avanzini, René Barbier et Michel Maffesoli
doivent ici être mentionnés et tout spécialement remerciés.
Qu'est-ce
que j'ai retenu alors de Carl Rogers et de l'attitude rogérienne ?
Peut-être
est-ce la
confiance,
maître mot de
l'attitude et de l'anthropologie rogériennes, qui constitua pour moi
l'apport capital. La confiance que j'avais aussi trouvée exprimée
chez les bouddhistes, chez Jung, avec sa conception optimiste de
l'inconscient, et au cours du travail analytique que j'entrepris
donc, avec une analyste jungienne. Il faut savoir que rien n'est plus
étranger à la confiance que le côté dogmatique, et
intellectualiste. La confiance, j'en fus l'heureux bénéficiaire et
elle inspira ensuite mon action en classe, me permettant de garder le
cap contre vents et marées.
La confiance m'aida à relativiser l'impact des blessures
narcissiques qui me furent infligées, notamment par les inspecteurs.
La
confiance est un sentiment, une attitude communicative, irrationnelle
et irraisonnée. Lorsque l'on fait confiance à ses élèves, ils
font tout, et même plus, pour se montrer dignes de cette confiance
et de l'amour que l'on a su leur montrer, « Il se passe alors
des choses incroyables », comme l'écrivait Carl Rogers, auquel
fait écho Delphine, une de mes anciennes élèves de seconde qui
m'écrivit : « Mais
j'admire beaucoup votre patience à notre égard, et surtout votre
compréhension. Je pense que l'autorité ne sert à rien, car tant
qu'un élève n'a pas envie de travailler, il ne travaillera pas,
même si le prof le colle ou le "gronde" en longueur de
cours. Vous pouvez nous apprendre à acquérir une discipline
personnelle intérieure. Personnellement, quand je sais qu'un prof me
fait confiance et qu'il me laisse des chances, je ferai plus
d'efforts à son égard et à l'égard de mon travail ».
Je
découvris aussi les salésiens de Don Bosco, grâce à Guy Avanzini.
Don Bosco, ce pédagogue chrétien qui exerça son action éducative
dans l'Italie du Nord, au XIXe
siècle, dans des conditions qui font penser à celles d'aujourd'hui,
surtout dans les quartiers difficiles et les zones d'éducation
prioritaire. N'étant pas moi-même chrétien, je pus cependant
facilement faire le lien entre
l'empathie
et l'acceptation
inconditionnelle d'autrui
d'une part, et ce que Don Bosco et les salésiens de Don Bosco après
lui (Xavier Thévenot, Jean-Marie Petitclerc) appellent
l'amorevolezza,
forme d'amour inconditionnel envers les élèves.
La
qualité humaine de la relation éducative est, en effet, décisive,
tant
sur le plan des apprentissages, que sur celui du développement
personnel des élèves et du professeur, sans ignorer la dimension du
Mal, que la gestion du groupe-classe me permit de découvrir, moi qui
étais ingénu et mettais
aux commandes l'État du Moi,
que l'analyse transactionnelle appelle le Parent
Sauveur.
La découverte de cette dimension du mal constitua un moment fort de
ma formation et évita que je ne succombe à la violence et à la
force destructrice, présentes dans tout groupe humain, réalité, je
l'appris à mes dépens, victime que j'étais de ma naïveté et de
mon angélisme. Je me posais comme règle de ne jamais prendre en
grippe les classes ou les élèves qui m'en
faisaient voir.
Cette attitude, autant tactique qu'inspirée de façon contraignante
par une morale imposée de l'extérieur, me permit, dans de nombreux
cas, de construire avec mes élèves des rapports harmonieux et basés
sur la confiance.
Être
rogérien dans un établissement scolaire est chose difficile, car
comme l'écrit Rogers lui-même, un enseignant rogérien (il se
méfiait en fait de cet adjectif) est souvent ressenti comme une
menace par
ses propres collègues qu'il lui faut rassurer, en même temps que
son chef d'établissement, envers lequel Rogers nous invite à un
sentiment de compréhension, dans un contexte encore assez largement
dominé par des rapports exagérément hiérarchiques et fondés sur
une conception ancienne, et incarnée par le père surmoïque, de
l'autorité. À ce propos, j'ai développé ailleurs l'idée d'un
nécessaire
compagnonnage entre tous les acteurs de la relation éducative, du
haut en bas de la hiérarchie : professeurs, parents d'élèves,
chefs d'établissements et inspecteurs.
L'attitude
rogérienne est formatrice sur le plan éthique et personnel, c'est
en tout cas, l'expérience qu'il me fut donnée de vivre. Elle
s'oppose à tout dogmatisme et nous oblige à travailler sur
nous-même, dans le sens de plus de maturité, plus de tolérance et
d'esprit d'ouverture. Un enseignant rogérien est tout, sauf un
révolté
incendiaire,
disait Rogers. C'est une personne sachant rester maître de sa propre
subjectivité et faire preuve, autant que faire se peut, de calme, de
patience et d'équanimité.
La
réflexion et la pratique éducatives comportent indubitablement un
aspect transférentiel. C'est Xavier Thévenot qui, le premier,
m'aida à comprendre que toute relation éducative un peu sérieuse
et authentique, comporte des aspects érotiques et s'accompagne
inévitablement de sentiments d'angoisse et de culpabilité, lesquels
doivent être partagés de façon équilibrée entre l'éducateur et
les éduqués. J'avais pendant longtemps pris sur mes fragiles
épaules tout le poids de cette culpabilité et de cette angoisse
inconscientes. Cette découverte vivante des mécanismes inconscients
en jeu dans la relation éducative marqua un autre moment fort de ma
formation.
C'est
Micheline Flak et le Rye
qui attira mon attention sur l'importance du corps, de
l'attention, du calme et de la maîtrise de soi, dans les processus
d'apprentissage et la qualité de la relation éducative. Pour
l'importance du cœur, il y eut donc Carl Rogers, Don Bosco et Carl
Gustav Jung, lequel écrit « Là où l'amour manque, le pouvoir
occupe la place vacante », et enfin
Krishnamurti.
Mon
parcours semblerait plaider en faveur d'une nouvelle formation des
enseignants, qui serait adaptée au contexte actuel.
Je serais tenté de reprendre ici les termes d'un de mes anciens
articles, pour appeler de mes vœux une
véritable auto-formation continuée des enseignants,
laquelle serait doublée et accompagnée d'une aide institutionnelle
sérieuse, adaptée et précédée d'une véritable formation
initiale.
Pour
conclure ces
quelques notes sur mon parcours professionnel d'enseignant, je dirai
que cette façon de considérer l'éducation et la pratique
éducative, sur les pas inspirés et précurseurs de Carl Rogers,
Carl Gustav Jung et Don Bosco, est une manière d'œuvrer à la
naissance d'un nouveau paradigme anthropologique, avec les
prolongements qu'il ne manquera pas d'avoir dans le domaine de
l'École.
_____________________________________________________________
|










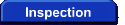
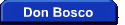



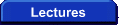

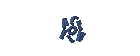

 Le
parcours d'un enseignant du secondaire
Le
parcours d'un enseignant du secondaire
