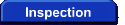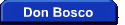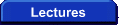|
|
 Le
Blog de Hans. Chroniques pédagogiques et littéraires
Le
Blog de Hans. Chroniques pédagogiques et littéraires
|
|
|
|
Le « problème
» de
l'Amour : Pedro Almódovar,
C.G. Jung et Rainer Maria Rilke
Nous
vivons à une époque de profonds chamboulements dans nos modes de
représentation et d'expérimentation du monde, dans nos échanges
avec autrui et dans notre façon d'aimer.
Les
anciennes lignes de force idéologique, éthique et archétypique
se déplacent. Nos traditionnels points de repère disparaissent.
Nous sommes dans une période de transition, avec toutes les
incertitudes dont cela s'accompagne. La sociologie et l'anthropologie
traditionnelles ne suffisent pas pour percer à jour ces mutations et
nous aider à comprendre les enjeux archétypiques actuels. Il nous
faut désormais recourir à une sociologie
des profondeurs
et à une
anthropologie archétypale,
sur les pas de Gilbert Durand et de Michel Maffesoli, penseurs qui
utilisent les outils que leur offre la pensée jungienne pour
éclairer ce que le second appelle la Postmodernité.
Il
nous faut désormais mettre sur pied une
nouvelle théorie anthropologique
se nourrissant des apports des sciences humaines, de la psychanalyse
et de l'anthropologie psychanalytique. Il nous faut accompagner
l'émergence d'un nouveau modèle anthropologique, modèle qui, à
notre insu, conditionne déjà notre existence dans tous ses aspects.
Marie-Louise Von Franz, disciple de C.G. Jung, appelait de ses vœux
cette nouvelle anthropologie, lorsqu'elle écrivait : « la
découverte des archétypes est de plus en plus en voie de fonder une
nouvelle anthropologie ».
Dans
le domaine psychologique, la mise en évidence du féminin
intérieur
dans l'homme, ce que Jung appelle l'Anima,
et celle du masculin
intérieur
chez la femme, autrement appelé Animus,
permet d'affiner l'analyse du monde intérieur et de parvenir à une
définition plus précise et subtile, de ce qu'est une femme et de ce
qu'est un homme, elle permet une description de la dynamique unissant
ces deux instances.
Les
chamboulements que nous sommes en train de vivre affectent et
bouleversent
parfois les relations hommes-femmes,
ainsi que la vie des couples,
comme ils affectent les relations adultes-jeunes, avec les
répercussions que cette détérioration entraîne dans le domaine de
l'éducation, à l'École, comme dans la famille.
La paternité, elle aussi, traverse une crise profonde et il n'est
pas facile, dans ce contexte, d'assumer sa paternité de façon
satisfaisante, et pour soi et pour ses enfants. Du côté maternel,
les choses ne semblent pas aller de soi, elles non plus. Certains
analystes de la société actuelle comme Élisabeth Badinter
interroge de façon critique l'instinct
maternel.
Rien
ne semble plus désormais acquis de manière définitive et stable.
Nous
pouvons aussi mesurer, avec le recul que permet le temps, les effets
à la fois positifs et négatifs, du féminisme,
en Europe et aux États-Unis, avec notamment l'apparition de la
masculinisation spirituelle de la femme occidentale, que pointaient
déjà Jung
et Rilke.
La
solitude
est désormais un phénomène fréquent, tant chez les hommes que
chez les femmes, comme s'ils n'étaient pas parvenu à construire des
relations satisfaisantes, à la fois pour l'un et pour l'autre. Les
divorces, les familles monoparentales ou recomposées sont des
phénomènes sociologiques qui attestent, à leur manière, d'une
grande instabilité de nos institutions, la famille, le mariage,
ainsi qu'une grande misère affective et sexuelle, malgré la
libéralisation des mœurs qui devait apporter à tous le bonheur.
L'identité
sexuelle,
elle aussi, semble problématique et incertaine. Le titre du livre
d'Élisabeth Badinter, L'un
est l'autre
semble pointer une certaine indifférenciation, laquelle est signalée
comme un simple fait par certains et souhaitée par d'autres. Pensons
aussi à la mode unisex.
Les films de Pedro Almodóvar, Tout
sur ma mère,
notamment, reflètent, eux aussi, de manière à la fois profonde et
drôle, l'état de notre civilisation et nous parlent d'un Amour
autre, enfin libéré du poids de la morale puritaine et de la
religion institutionnalisée.
*
* *
L'Amour,
ou plutôt le
problème de l'amour,
selon les propres termes de Jung, « constitue une des grandes
souffrances de l'humanité et personne ne doit avoir honte de lui
payer un tribut ».
La
question de l'Amour n'a sans doute jamais été simple ou anodine, il
suffit de se reporter aux nombreux mythes qu'il a nourri dans notre
culture occidentale, dont celui de Tristan et Yseult, mais les choses
semblent se poser de façon nouvelle.
Le
fait que l'Amour s'accompagne souvent de souffrance et qu'il faille
lui payer
un tribut,
nous
empêche de le traiter avec frivolité, en nous contentant de mettre
en avant la réaffirmation narcissique de nous-mêmes ou la
réalisation forcenée de tous nos désirs.
Voici
ce qu'écrivait Rainer Maria Rilke,
en 1904, à propos de l'Amour et de l'évolution des rapports
hommes-femmes, tels qu'il se les représentait et tels qu'il les
rêvait : « Or il est clair que nous devons nous en tenir à ce
qui est difficile. (…) Aimer est aussi une bonne chose, car
l'amour est difficile. Que deux êtres humains s'aiment, c'est sans
doute la chose la plus difficile qui nous incombe, c'est une limite,
c'est le critère et l'épreuve ultimes, la tâche en vue de laquelle
toutes les autres ne sont que préparation. (…) Mais le temps de
l'apprentissage est toujours une longue période, une durée à part,
c'est ainsi qu'aimer est, pour longtemps et loin dans la vie,
solitude, isolement accru et approfondi pour celui qui aime. Aimer,
tout d'abord, n'est rien qui puisse s'identifier au fait de se
fondre, de se donner, de s'unir à une autre personne (que serait, en
effet, une union entre deux êtres indéfinis, inachevés, encore
chaotiques ?) ; c'est pour l'individu, une extraordinaire occasion de
mûrir, de se transformer au sein de soi, de devenir un monde, un
monde en soi pour quelqu'un d'autre ; c'est, pour lui, une grande et
immodeste ambition, quelque chose qui le distingue et l'appelle vers
le large. (…) Les exigences imposées à notre développement par
le difficile travail de l'amour dépassent les bornes de la vie, et,
débutants, nous ne sommes pas à leur hauteur. Si toutefois nous
tenons bon, et si nous assumons cet amour comme une charge et un
apprentissage, au lieu de nous perdre dans tout ce qui est jeu
frivole
et facile – derrière lequel les hommes se dissimulent la gravité
la plus profonde de leur existence –, ceux qui viendront longtemps
après nous, ressentiront peut-être un soulagement et quelque menu
progrès – ce serait beaucoup ».
Puis,
le poète se prenait à rêver et à prophétiser
ce
que l'Amour allait, selon lui, devenir : « Ce progrès va
modifier l'expérience de l'amour qui actuellement est pleine
d'erreur (tout d'abord en s'opposant fortement à la volonté des
hommes qui seront dépassés), la transformera fondamentalement, la
convertira en une relation pensée comme un rapport d'être humain à
être humain, et non plus d'homme à femme.
Et cet amour plus humain (qui procédera avec infiniment plus
d'égards et de douceur, bon et simple dans ce qu'il nouera ou
défera) ressemblera à celui que nous préparons péniblement, non
sans lutte, à cet amour qui consiste en ce que deux solitudes se
protègent, se bornent et se rendent hommage ».
____________________________________________
Trois
nouveaux Contes de la Folie Verte
La vie brève
Jeremias
La Maison
Close

 La vie
brève La vie
brève
La voisine bâilla alors et traîna un
fauteuil. Il pleuvait sur la campagne. Hans reprit la lecture de La
vie brève, un court instant
interrompue par ce bruit d’un fauteuil voltaire traîné sur un
parquet flottant. Elle rit. La femme rit, ce qu’elle ne faisait pas
dans le roman onélien que Hans était en train de relire. La
ressemblance entre le roman qu'il était en train de lire et sa vie
qui continuait, s’arrêtait donc là. Elle rit, à gorge déployée,
oui, puis son grand rire soudain décrut.
Une voix mâle et haut perchée se fit
entendre derrière la cloison, une voix que ce rire avait sans doute
mis hors d’elle et qui y avait donc brutalement mis fin, profitant
de sa supériorité physique toute musculaire pour imposer ses désirs
de silence feutré à la femme qu’il aimait encore et qui riait de
se voir si belle et tant aimée. Le rire un instant perçu,
s’éteignit, en effet, comme les braises qui s'éteignaient aussi
les unes après les autres. Après avoir seulement décru, pour
tenter sans doute de calmer la colère de cet homme qui ne semblait
pas avoir envie de rire ou d’ouïr le rire d’autrui, le rire,
c’est vrai, s’était brutalement tu et Hans reprit sa lecture
têtue, à peu près à l’endroit où il l’avait abandonnée
lorsque ce rire que l’homme paraissait trouver intempestif, était
venu le tirer de sa rêverie et de sa lecture.
Pourquoi tant de cloisons, tant de portes,
tant de vitres ? Cette question taraudait Hans.
Chez Juan-Carlos Onetti, beaucoup de choses se
passent derrière des vitres, derrière
des portes, derrière des cloisons, remarqua-t-il alors, posant La
vie brève sur le manteau chaud de
la cheminée. S’il ne semble pas
croire en l’Au-delà, le mystère de l’au-delà est pourtant déjà
là poétiquement présent, convoqué par le charme des mots. Le
romancier est nostalgique d’un Monde à venir qui ne viendra
peut-être jamais, mais est, curieusement, déjà là d’une secrète
présence plus pleine que le monde. La lumière est accompagnée de
son indispensable ombre énigmatique, laquelle est habitée d’autant
d’indicibles présences que l’est la lumière elle-même. La
nostalgie onétienne, envoûtante et pénétrante, nous rend présent
l’au-delà. Le réel n’est pas chosifié, il est
ridiculisé,
au profit d’une mystérieuse réalité plus poétique que lui et
plus digne d’être vécue que ne l’est le réel. Il est déchiffré
à l’aide des clefs dont le romancier est un des rares possesseurs.
Onetti est bouddhiste, ou tout simplement poète, il fait exister,
par son Art, sous nos yeux émerveillés et reconnaissants, la
Poésie, le Réel. Onetti est un mystique, se dit Hans en sirotant
son déca et en regardant les flammes danser devant ses yeux, comme
une odalisque nue et mue par le seul désir de lui plaire.
 Jeremías Jeremías
Il faut dire que, lorsqu’il était petit,
Jeremías n’était pas facile. Lorsque, pour l’endormir, nous lui
lisions, María ou moi, des contes de fée, il manifestait déjà
bruyamment son esprit de rébellion et faisait preuve d’un sens
critique que je n’avais pourtant rien fait pour développer plus
que de raison. Pour tenter de le convaincre, autrement que de
manière autoritaire, de la nécessité où il se trouvait de
m’écouter lui conter Blanche-Neige
et
les sept nains,
d’y prendre un plaisir légitime, d’y éprouver de la peur ou un
peu d’intérêt même feint et poli, il me fallut lui lire, et
commenter doctement avec lui La
psychanalyse des contes de fée. Le
seul livre qu’il supportait que nous lui lisions, et encore,
c’était La philosophie dans le
boudoir. Il partait alors d’un
grand rire dont je ne suis pas sûr, même aujourd’hui, de
comprendre le sens véritable. Il aima aussi le poème d’Agrippa
d’Aubigné qui dit :
Comme un nageur venant du
profond de son plonge,
Tous sortent de la mort comme
l’on sort d’un songe.
À peine en avais-je achevé la lecture qu’il
criait en trépignant et en battant frénétiquement des mains :
Encore ! Encore !,
comme certains enfants moins précoces réclament Les
trois petits cochons sans cesse et
en boucle. Il prit aussi du plaisir, c’est vrai, je m’en
souviens, le soir où je lui lis, contre l’avis de sa mère,
d’ailleurs, Madame Edwarda
et l’un des chants de Maldoror.
Pour qu’il consentît à prendre librement son envol cultivé et à
lire lui-même sans l’aide de personne, il fallut lui acheter De
l’inconvénient d’être né et
Précis de décomposition
qu’il lut d’une traite et en silence. Pendant plusieurs jours, il
ne sortit pas de sa chambre. Non, Jeremías n’était pas facile. Il
parlait sans cesse du Droit des
enfants et chantait, pour nous
embêter, sa mère et moi, une chanson insane et pleine de révolte
vaine, qui disait, je m’en souviens encore, Je
n’ai pas demandé à vivre ici.
Comment le convaincre, me demandai-je souvent
à l’époque, que la vie vaut la peine d’être vécue ?
Lorsqu’il était encore dans le ventre obscur de sa mère, j’avais
pourtant écrit à son intention une chanson que nous lui chantions à
tour de rôle, comme des propagandistes têtus, car les psychologues
prétendaient en ce temps là qu’une communication secrète,
profonde et décisive s’établissait entre le petit d’homme et
les coupables de sa naissance. María, maternelle, lui chantait, avec
un petit accent vénézuélien charmant : Un
petit coin de parapluie / contre un coin de paradis / je ne perdais
pas au change, pardi.
Nous culpabilisions tant certains soirs de
pluies torrentielles de lui avoir donné ou plutôt imposé la vie,
que nous n’osions rien lui refuser. C’est ainsi que je l’emmenai,
contre l’avis puritain de María, rue Saint Denis, à sa demande
insistante et le laissai seul avec son étonnement, son dégoût et
un billet de 50 euros plié en quatre.
Il se mit précocement, sans doute pour nous
contrarier, à tourner en dérision la
Morale des Droits de l’Homme et
la pédagogie citoyenne. Nous
faillîmes même, à cause de lui, avoir des ennuis sérieux avec des
voisins de palier qui allèrent nous dénoncer à la Police
politique, arguant du fait qu’il était totalement impossible qu’un
enfant si jeune eût pu développer seul une pensée si cohérente et
corrosive.
- Un peu de ketman,
Jeremías, dus-je lui dire, en le fixant droit dans les yeux d’un
air sévère. Il me fallut après cette semonce, faire la preuve
irréfutable de notre bonne foi et m’excuser publiquement. Nous
avions failli nous voir enlever la garde de Jeremías, ce qui nous
eût certes laissé davantage de temps pour lire, rêver et
vagabonder, mais dont, vraisemblablement, nous ne nous fussions pas
remis psychologiquement et moralement. Car nous aimions Jeremías de
manière incorrigible. Je me rendis même compte vers cette époque
que Jeremías était, avec María, le seul être que j’aurais pu
défendre, même au péril de ma vie, avec Carlota, peut-être ?
avec Hayet, Samira, Horia, Nalguitas, Nadja, Angela, Claire, Laura,
Pickwick, Diogène, Cerbère, Artémis et même Hécate ?
Pour tenter une nouvelle fois de le
convaincre, face à un pessimisme qui s’installa dans sa
dix-huitième année, que la vie valait la peine d’être vécue
avant de mourir, j’eus l’idée de lui acheter les œuvres
complètes de Henry Miller. Il les lut sans renâcler en anglais et
pendant un certain temps, il rentra tard dans la nuit, autant dire le
matin du jour suivant, apparemment content, en se cramponnant à la
rampe, en ramenant des amies qui semblaient lui en être
reconnaissantes.
Le moment de plus grande complicité entre
nous fut sans nul doute celui où nous fîmes ensemble du roller. Il
avait quatorze ans, peut-être ? Et je fis tout alors pour qu’il
ait et conserve de moi une image positive. J’allai même jusqu’à
me faire faire un tatouage qui représentait Jung fumant la pipe et
en train de rédiger la deuxième partie de Mysterium
conjunctionis. Même ses copains
n’en revenaient pas. C’est vers cette époque d’ailleurs qu’il
commença à se faire sans trop de violence à l’idée que nous
pûmes, María et moi, être ses géniteurs, qu’il me jugea digne
de vivre à plein temps sous le même toit que sa mère et lui et
qu’il insista pour que María et moi nous nous mariâmes sous son
regard complice et approbateur. Nous ne reculions devant aucun
sacrifice pour tenter de lui faire plaisir et nous gagner ses bonnes
grâces et son amour. Nous nous mariâmes, donc. Il y eut aussi les
fois, deux ou trois, pas plus, malheureusement, où nous allâmes
ensemble, accompagnés de Pickwick, ramasser des escargots, après la
pluie, le jour endeuillé de la mort de Pickwick, justement, et les
longues soirées d’hiver où nous écoutions, assis tous les
quatre, avec María et Pickwick, La
Messe de la Création, sans oublier,
naturellement, Les Fêtes de la
Sardine durant lesquelles Jeremías
avait le droit de se tenir mal à table et même de dire des gros
mots.
Parfois, Hans pensait aussi à sa mère sans
amertume. Il se disait alors à lui-même ce que d’autres lui
avaient déjà dit : Une mère,
on n’en n’a qu’une.
Heureusement ! s’empressait-il d’ajouter intérieurement, et
sans transition matrilinéaire aucune, il se demandait : Quel
père ai-je été ? C’est
sa conscience qui le lui demandait, elle qui avait le sens de
l’à-propos très développé. Quel
père as-tu été ? lui
répétait-elle, avec une insistance moralisatrice et déplacée.
Parfois, il rêvait de faire encore du roller avec son fils, malgré
son âge un peu avancé. Aujourd’hui, il était triste, perclus de
rhumatismes et, pour comble de malheur, la Fnac
était fermée. Impossible
d’acheter du rêve ou de rencontrer une nouvelle femme éprise de
culture et prête à se donner à un homme vraiment cultivé, il
rentra chez lui. Il avait un peu abusé sur les canettes :
- Moi, hurla-t-il, je suis contre le suicide.
Dehors, un oiseau chantait. Ils l’écoutèrent
un instant. Il finit de la déshabiller et lui fit l’amour pour de
vrai. Elle semblait contente. Lui, aussi, d’ailleurs.
- Prends ta pilule du deuxième jour, lui dit
Hans, rieur, lorsqu’ils eurent vraiment fini.
Comme elle faisait alterner les signes de son
acquiescement et ceux de son refus, criant oui, oui, puis non, non,
Hans avait dû lui dire sèchement que ton
non soit un non et que ton oui soit un oui.
Il faut parfois savoir être ferme avec les femmes.
Hans a bien des défauts.
On peut lui faire plus d’un reproche justifié, mais, en tout cas,
il n’est pas raciste. Il ne refuse jamais les avances d’une
négresse ou d’une fille des îles et, lorsqu’il est à la
bourre, il ne voit aucun inconvénient à recourir au service d’un
nègre pour terminer un roman que les circonstances adverses ou la
paresse l’ont empêché de mener à terme. En
plus, il est patriote, un patriote au grand cœur qui ne se contente
pas d’aimer comme une mère, doublée d’un père, ses trois
patries : l’Allemagne, la France et le Vénézuéla. Son
patriotisme est planétaire et n’exclut ni les arbres, ni les
pauvres, ni les espèces animales qui ne sont pas encore menacées de
disparition. Il donne l’aumône aux pauvres, surtout à ceux qui
parlent français, allemand ou espagnol, afin d’échanger autre
chose que des regards compatissants, polis et reconnaissants. Il
exclut cependant de sa générosité le pauvre parlant anglais avec
un fort accent d’Amérique du Nord.
Dans la ville des Sacres, Hans avait été
heureux. Il aimait s’asseoir le soir sur un banc propre et regarder
longtemps la mer au loin, espérant revoir Dieu comme à Mers. Un
jour, il eut la chance de vivre pour la modique somme de trois euros
la journée infinie.
Au début, il se prit pour Dieu, il était content, il remerciait
sans cesse le ciel de lui avoir permis de faire cette expérience
qu’il croyait mystique, puis il finit par trouver le temps long et
s’ennuya. Un peu, au début, puis de plus en plus. Le délai
d’attente était long pour retrouver un temps plus imprévisible et
contingent. Il fallait prendre son mal en patience et tenter de vivre
l’éternité au jour le jour, sans
se poser trop de questions vaines et sans se projeter névrotiquement
dans un avenir meilleur.
 La
Maison Close La
Maison Close
De retour rue Quincampoix, nostalgique de la
pureté de l'air romain, et déçu d'avoir été trahi par María,
Hans se mit à flotter de nouveau. Il reprit alors ses pèlerinages
curatifs et thérapeutiques rue St Denis et se remit à fréquenter
avec assiduité La Maison Close. Dans
une corbeille à papiers désormais vains et inutiles, près d'une
cheminée urbaine en marbre que l'on n'allumait plus, ou rarement, se
trouvaient des boîtes usagées de lentilles vertes one
day faites pour se rincer l'oeil au
moment du lent strip-tease préliminaire qui ouvre l'appétit des
sens, un instant assoupis. Dans le salon d'attente de cette Maison
Close ouverte pour la circonstance, il y avait une petite table basse
en osier, avec des numéros luisants de Lui
et de Elle,
une série de Play Boys
et des numéros anciens de Fais-moi
tout, interdits par la loi, quelques
vieux numéros de L'Huma,
ainsi qu'une play station pour les jeunes qui venaient jeter leur
gourme ici et trouvaient le temps d'attente long, ce temps qui les
séparait presque éternellement de la rencontre avec le plaisir des
sens et avec le spectacle de la nudité rêvée qu'ils espéraient
rencontrer grâce aux bons offices de ces vestales vénales,
généreuses de leur corps et compatissantes. Il y avait sept
fauteuils en osier disposés sensuellement autour de la table
d'osier, donc, elle aussi. Trois clients à l'âge incertain
attendaient leur tour, comme chez le dentiste, lisant des revues
pornos, culturelles et politiques pour tromper l'ennui et le temps,
mais aussi pour accélérer la montée de la sève ludique et
érotique. Ils n'osaient pas se regarder l'un l'autre, de peur d'être
pris mutuellement en faute, et les cris qui sortaient de derrière la
porte pourtant capitonnée leur fit un moment peur. Le client
souffrait-il ou était-il si content de sa passe payante qu'il lui
fallait exsuder une partie du plaisir reçu et donné pour ne par
mourir étouffé ?
Hans perçut une voix à son adresse qui
provenait des lèvres épaisses et charnues d'une femme que l'on ne
pouvait pas voir vraiment, car elle était en partie cachée dans
l'embrasure de la porte capitonnée entrouverte. Il se leva
timidement, comme s'il venait au Bordel pour la première fois, et
qu'il n'avait que dix-sept ans. Une main manucurée outrageusement,
mais belle et bien dessinée, qui devait appartenir à la voix
féminine et sensuelle qui avait lancée engageante : Hans, apparut, dépassant
légèrement de l'embrasure de la porte ouvrant sur l'antre
mystérieux, vénal, mais désirable. Hans disparut comme happé par
l'appel du plaisir défendu longtemps différé. On entendit un
pantalon descendre prestement, et sans transition ou presque, des
cris à la fois masculins et féminins. Puis, plus rien. Hans
était-il mort en un dernier râle sur le ventre aimé de la vestale
vénale ? Puis des bruits de frou frou, une jupe plissée et courte
longeant sans doute les murs de l'antre, des stores baissés avec
l'aide d'une manivelle vraisemblablement mal graissée. Que se
passait-il ? Hans était-il mort de plaisir ou de rire ? car, avant,
c'est vrai, on avait entendu d'énormes éclats de rire, puis des
rires semblables à ceux que provoque le caressement de pieds
chatouilleux, incapables de se retenir et de rester maîtres
d'eux-mêmes et calmes. Lorsqu'il se retrouva en bas dans la rue, au
pied de l'immeuble vénal, après être monté, il lut sur la façade
léprosée, une plaque sommaire et bon marché, qui disait : VÉNUS.
70 Euros. Sur
rendez-vous. Rapports protégés. septième étage, porte gauche en
sortant de l'ascenseur.
Lui, avait toujours rêvé, depuis cet âge
lointain où ce genre de rêves s'incrustent en nous, d'avoir en bas
de chez lui, une plaque en marbre noir et chic gravée en lettres
d'or :
Hans. Thérapie Centrée sur la
Personne. Sur rendez-vous uniquement. Mal de vivre, dépressions en
tout genre, Spleen baudelairien, Mal du pays et Nostalgie de
l'au-delà.
Se déplace en cas d'urgence.
Non conventionné. Honoraire et esprit
libres.
Spécialités : tendances suicidaires et
dévalorisation de soi-même, avec ou sans la complicité des autres.
Lecture de contes lointains, latino-américains et archétypiques.
Formation à l'écoute de lieder schubertiens. Analyse stylistique et
existentielle des œuvres de Juan-Carlos Onetti.
Résultats et plaisir garantis.
Contact
Jean-Daniel ROHART
51100 Reims
jeandanielrohart@hotmail.com
|