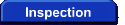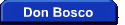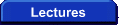|
|
 Comptes-rendus
de lecture
Comptes-rendus
de lecture
|
|
On reconnaît les vrais professeurs, ceux qui sont
faits pour enseigner, contre vents et marées, à leur esprit d’aventure, à leur
enthousiasme, à leur goût prononcé pour le défis et pour la difficulté, à leur
entêtement, à leur persévérance que rien ne semble pouvoir entamer. On peut
dire d’eux qu’ils mènent une véritable quête, quête
de l’impossible. Ce sont des condottieres, des
aventuriers, des croisés, dont le but et l’ambition est de « donner forme
au chaos », selon l’expression heureuse de Mara Goyet. Ce sont des êtres à
l’esprit libre, des artistes, car la pédagogie est un art, en effet, un art
incertain et problématique, mais qui fait connaître à celui ou celle qui
l’exerce, des moments d’un indicible bonheur, le bonheur que procurent la
Beauté, le Bien, la Vérité, et le devoir dûment et loyalement accompli, le
bonheur qu’il y a à vaincre des difficultés que l’on croyait insurmontables.
Les vrais professeurs tiennent
bon au plus fort du
découragement. Le découragement, d’ailleurs, n’est, chez eux, que passager,
leurs échecs les stimulent plus qu’ils ne les découragent.
Mara Goyet appartient à cette catégorie d’êtres un
peu fous, tant leur espoir et leur confiance en eux-mêmes et en leurs élèves,
paraît totalement déraisonnable, à première vue. Ils veulent comprendre les
êtres et les situations parfois déroutantes et inextricables, auxquelles ils se
retrouvent confrontés en classe. Ils écoutent, ils regardent, soupèsent,
attendent, s’arrêtent, repartent en avant de plus bel. Ils s’auto-éduquent, en même temps qu’ils éduquent, ils ne sont pas
autosuffisants et arrogants. Ils connaissent les limites de leur action
pédagogique. La difficulté du métier les a rendus humbles et réalistes. Ils ne
baissent pas pour autant les bras.
En eux s’incarnent les archétypes de Dionysos, Mara
Goyet parle de la geste
sancto-dionysienne, ainsi que
celui du Puer Aeternus et du Fripon-Divin. Les
enseignants, lorsqu’ils restent en phase avec la réalité profonde de l’École,
ont quelque chose de saltimbanques, de funambules aussi, voire de clowns, ils
font en effet penser à l’archétype du Fripon-Divin, autrement appelé Trickster[2].
Ils sont capables, cette collègue nous le dit, de
rendre Perceval de nouveau perceptible à une classe agitée, paumée et au départ
éloignée de cette réalité mythique éternelle, ils animent en classe les mythes
grecs, au lieu d’étudier des textes insipides démagogiquement voués à capter
l’attention des élèves et à réveiller leur intérêt assoupi, car les élèves,
Mara Goyet en fait l’expérience au quotidien, aiment apprendre, ils aiment être
surpris et dérangés dans leur routine.
Les vrais professeurs sont plus nombreux qu’on ne
l’imagine, ils connaissent l’émotion de voir le
visage d’un élève s’éveiller, sortir de sa stupeur et de son ennui, parce qu’il
vient de comprendre, grâce à son professeur, quelque chose qui fait sens pour lui. Les vrais professeurs sont restés vivants. Ils bricolent, rusent, feintent[3], pour faire avancer leurs élèves sur le chemin de l’éveil,
du sens et de la compréhension. Ils prennent plaisir, tel St Christophe, à porter les élèves sur le chemin de l’accomplissement
d’eux-mêmes, à montrer le chemin aux autres, même si « la direction à prendre
n’est plus évidente »[4]. Et pourtant, ils avancent, sans savoir vraiment vers quels horizons, tant
l’avenir est incertain. Ils avancent, comme dit la chanson, « d’aventure
en aventure », ou de commencement en commencement, pour parler comme les
Mystiques. Ils se savent faibles, mais ils sont fragiles et forts à la fois, ils ne nourrissent plus le mythe de la maîtrise
parfaite. Ils tournent le dos au prométhéisme et au vertuisme, ainsi qu’au
pédagogisme et aux consignes de l’Institution, s’ils les savent par expérience
absurdes et contreproductives.
Ils ont appris à jongler avec les difficultés, à surfer sur les problèmes, à danser, crier, rire ou pleurer,
parfois. Ils y croient encore
fermement à leur métier, une mission presque, voire un sacerdoce laïque, même
si rien dans leur quotidien ne justifie une telle foi, un tel courage, une
telle confiance. Ils se disent et se répètent à eux-mêmes : « À force
de foncer, de lutter, d’y croire, le professeur (que je suis) obtiendra
l’impossible ». Ils ont une vision tragique de l’existence et de leur
métier. Ils évitent de sans cesse se plaindre et de rendre les autres,
l’Institution, ou la société, responsables de la situation qu’il leur est donné
de vivre. Ce sont des conspirateurs, comme dit Carl Rogers, des aventuriers, des
conspirateurs de l’intérieur et non des révoltés incendiaires
ou des militants à l’ancienne. La révolution qu’ils mènent, est une révolution tranquille, selon les termes du même
Carl Rogers[5]. Rien ne peut les décourager définitivement. Ils ont
l’esprit de sérieux, doublé d’humour et d’humilité.
L’amertume ne suinte pas du témoignage que nous donne
Mara Goyet, dans son nouveau livre Collège brutal. Après
quinze années passées à tenter d’enseigner des élèves de ZEP, puis en centre
ville, tout en les éduquant, aussi un peu, au passage, puisque de nos jours,
comme l’écrit cette collègue, les deux
activités que sont l’enseignement stricto sensu et l’éducation au sens large,
ne sont plus séparées par une barrière étanche. Qu’on le veuille ou non, il
nous faut aussi assumer « les dimensions les plus prosaïques du
métier »[6] et enseigner, par exemple, la politesse aux élèves
qui ne savent pas encore ce que c’est. Il ne sert plus désormais à rien de
répéter que le rôle d’éducation revient exclusivement à la famille. Vœux pieux,
refus d’assumer le réel tel qu’il est, et non tel que nous voudrions qu’il
soit, forme mineure de la lâcheté et de l’esprit de démission. Refuge sur les Hauteurs et refus d’assumer la Vallée, avec sa part d’ombre et ses incontournables
pesanteurs. Mara Goya « ne répugne
pas à éduquer »[7], mais pour cette enseignante, cela ne signifie pas,
se transformer en assistante sociale ni en maman.
Le témoignage de cette collègue ne nous apprend rien
de nouveau sur le délabrement de l’École. On y retrouve les mêmes mots que dans
les autres témoignages émanant d’enseignants en exercice. Elle nous dit ce que
nous ne savons malheureusement que trop bien, surtout si l’on a soi-même
enseigné. Que « le système est à bout de souffle », que l’on a
affaire à « un gigantesque naufrage »[8]. On retrouve sous sa plume les mots de désastre, de marasme et elle ajoute
que le système est
devenu complètement absurde[9] et ce dernier point, l’absurdité, représente peut-être une nouveauté par rapport au
contexte de l’École des années 80. Cette collègue nous explique de manière
simple, parfois amusante et toujours convaincante, ce que nous ne savons aussi
malheureusement que trop bien, à savoir que « Notre institution semble
chaque jour davantage préoccupée par son fonctionnement, son organisation, sa
rationalisation, que par le niveau de ses élèves »[10].
Et pourtant, le témoignage que nous offre Mara Goyet,
dans son nouveau livre, ne se réduit pas à ce triste constat de l’état de notre
École. Il est porteur d’un autre message. Message d’espoir, peut-être !
Elle nous dit que l’on peut encore, et malgré tout, prendre plaisir à enseigner, sans se transformer en assistant social, en psy,
mais en étant pourvu de ce qu’elle appelle un bon sens enseignant. Elle nous rappelle qu’aimer les élèves n’est pas
forcément un handicap. Elle précise : « Il ne s’agit pas de les aimer
un par un, de les aimer comme on aime ses enfants (…) Mais il s’agit d’aimer
l’enfance (…) D’aimer cet âge incertain qui désire encore apprendre mais est
déjà un peu blasé, cet âge ingrat qui fanfaronne mais se laisse aussi avoir à
tout bout de champ, d’aimer cette période de la vie où tout semble s’installer,
la culture, la civilisation mais aussi les lacunes, les blessures et les
échecs, cet âge chaotique, haletant compte à rebours avant le conformisme éternel »[11].
« Avoir un bon feeling », cela n’est pas
honteux pour un professeur, lance-t-elle. Elle nous rappelle donc et fort
opportunément ce que toutes les personnes qui enseignent de nos jours savent, à
savoir que « la distinction entre éducation et enseignement (…) paraît de moins
en moins évidente »[12] et que l’on est condamné à concilier des tâches qui
autrefois étaient distinctes, l’École instruisant, tandis que la famille
éduquait. Elle pointe avec raison cette tendance à la bureaucratisation et au fliquage permanent des
enseignants :
« l’obéissance, écrit-elle, prime sur la performance »[13] et le professeur « devient acteur de son propre
contrôle »[14]. Il s’auto-évalue sans cesse, comme il passe sont
temps à évaluer les
compétences de ses élèves. Les
professeurs remplissent des livrets de compétence,
des cahiers de textes en ligne. On leur demande de brasser du vent et d’évaluer
le néant. Mara Goyet évoque « La multiplication des tâches administratives,
qui font perdre aux professeurs, leur élan, leur créativité, leur spontanéité,
laquelle est tuée par une bureaucratie obsessionnelle à la Courteline »[15].
La spontanéité, d’ailleurs, est désormais considérée
comme une forme de déviance idéologique[16]. Mara Goyet dénonce le poids grandissant de l’idéologie, des positionnements idéologiques dont elle n’aime,
ni la rigidité, ni le confort illusoire, ni le caractère répétitif[17].
Les enseignants des années 70 se voyaient reconnaître
une certaine liberté pédagogique, ils pouvaient encore, malgré les difficultés,
enseigner dans le fil de leur bois, enseigner avec âme. En 2012, cela ne semble
plus être possible : « On nous coupe dans nos élans. On nous bride.
On nous occupe de tâches débilitantes, on cherche à nous abrutir »[18]. Les enseignants sont fliqués[19]. « Les procédures prennent totalement le pas sur ce qui se joue en
classe »[20]. Ce sont les experts qui règnent sur
l’École, instaurant un véritable
règne des experts[21]. « Toute initiative doit passer par des autorisations en tout
genre, des formulaires, de nouveaux systèmes d’évaluation »[22]. Des « brigades de petits chefs » sont là
pour faire respecter l’ordre et les consignes, ils veillent à ce que chaque
professeur remplisse les nombreuses tâches administratives qui désormais leur
incombent. « On multiplie les pressions », écrit Mara Goyet[23].
Aussi, une consigne qui, autrefois pouvait passer
pour contestable, à savoir, mettre l’élève au centre de l’École, reprend-elle toute son actualité dans l’actuel
contexte, formaliste et bureaucratique, où ce qui semble prévaloir n’est pas
que les élèves soient instruits et éduqués, mais que le système perdure en
l’état, ce qui pousse ses partisans, la hiérarchie moyenne (inspecteur, chef
d’établissement), et les décideurs, à tenir des discours autojustificateurs qui
visent à pérenniser un fonctionnement, une organisation et une rationalité qui
n’a de rationnel que le nom. Ce qui compte, c’est que l’École continue de
fonctionner, même si c’est à vide.
Il faut beaucoup de force aux enseignants actuels
pour résister à une telle entreprise de décervèlement et de mise au pas. Et le
constat établi par cette collègue lucide et motivée, est sans appel :
« nous avons perdu notre élan », lance-t-elle. Le poids de l’institution, de ses règles, consignes et règlements en tout
genre, empêche les enseignants encore motivés de sauver ce qui peut l’être[24], alors qu’« avec un peu plus de liberté dans le mouvement, on
pourrait arranger les choses ». D’un côté, l’École met en avant
l’épanouissement des élèves, « elle se vautre dans un délire de mièvrerie
consensuelle »[25]. De l’autre, elle met en place un fonctionnement de type dictatorial, d’« une brutalité sans égale ». Elle
continue à imposer à l’ensemble des élèves, de la maternelle à l’université, un
idéal qui remonte au XIXe siècle et n’est en rien adapté aux besoins
du XXIe siècle. Et cette imposition est d’autant plus perverse et
pernicieuse, qu’elle se pare de vertus et de beaux sentiments égalitaires[26] et généreux. Comment prétendre, en effet, échapper à
l’emprise d’un tel système qui entend, à l’en croire, faire le bonheur de tous,
assurer l’égalité entre tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale
et élever le niveau général de la culture dans notre pays ?
Jean-Daniel Rohart
La littérature sans estomac
|
|
|
Jetant
un regard drôle, acéré et décapant sur la littérature actuelle
et en dressant un large panorama, Pierre Jourde avance l'idée que
« la banalité (y) tient (souvent) lieu d'inventivité ».
L'auteur de La
littérature sans estomac,
inventorie ces livres qui n'ont « rien à (nous) raconter, à
part une histoire banale et inepte ». La banalité des
histoires et des personnages s'étale de nos jours, c'est vrai, à
longueur de pages, mais si l'on en croit les auteurs de ces médiocres
fictions, il s'agirait d'un banal
extraordinaire
transcendant le banal ordinaire, alors que l'on aurait pu croire
qu'il s'agissait d'occulter sa propre banalité en faisant de la
banalité la norme de toutes choses. La banalité ne serait
qu'apparente, elle serait due à la mauvaise qualité de notre
regard, un regard trop hâtif et superficiel, dont l'auteur viendrait
nous guérir, rééduquant notre manière d'appréhender le monde et
nous faisant retrouver la dimension « poétique » du
quotidien le plus banal et ordinaire, contribuant par son « art »
à nous faire retrouver goût pour le monde et la vie simple, au
mépris de toute exigence ontologique un peu sérieuse, mais
n'excluant nullement l'humour.
L'intensité
et l'authenticité ne sont pas mises
à l'honneur
dans tous ces récits ennuyeux, il suffit de faire
intense,
de faire
authentique.
Si le critère moral n'est pas premier en matière de littérature,
il existe cependant chez tout écrivain un respect de la vérité ou
une absence totale de vérité, laquelle n'entraîne pas une
condamnation morale mais provoque un dégoût certain et un profond
ennui, le lecteur ayant l'impression qu'il a droit à un certain
respect de la part de l'auteur, tout comme le réel a aussi droit à
une certaine forme de respect et n'est pas là pour servir de
faire-valoir au narcissisme et à la bêtise de celui qui
s'auto-proclame écrivain avec la complicité du monde éditorial et
de certains critiques sans âme. « Le vertige (c'est vrai)
saisit » parfois le lecteur face à tant de médiocrité fière
d'elle-même et tout notre être refuse de participer à cette triste
farce.
Dans
la société actuelle, il y a plus grave, peut-on être tenté de
penser, mais on peut aussi considérer que le triste état de notre
littérature est un symptôme qui nous parle de l'état de notre
société et que la pseudo littérature qui a tendance à proliférer
et à nous envahir reflète des phénomènes de décomposition, de
déréalisation et de dépoétisation. « L'invasion de ces
niaiseries étouffe
la littérature française », elle étouffe nos contemporains,
surtout ceux qui, dans leur quête, attendent beaucoup de la
littérature et ne souhaitent pas qu'elle se réduise à un
passe-temps comme un autre, considérant qu'elle peut contribuer à
modifier le réel en profondeur, qu'elle peut nourrir l'Âme du
lecteur et celle du monde et que le recours aux métaphores n'obéit
pas à une simple exigence stylistique, n'est pas une technique parmi
d'autres, mais engage tout un rapport au monde et postule qu'il
existe un arrière-monde qu'elle cherche à faire apparaître en
établissant un réseau de correspondances entre le monde tel qu'il
est dans son prosaïsme et celui qu'un regard plus acéré cherche à
révéler à notre conscience.
Un
style qui revendique haut et fort sa sécheresse et son dépouillement
systématique et qui dédaigne résolument la métaphore traduit une
attitude existentielle particulière, contribue à l'appauvrissement
du monde, il conduit inéluctablement à une déréalisation
qui est aussi désincarnation
et perte de l'Âme (p.67) car en littérature, le corps et l'âme, le
style, les mots et le fond sont indissociablement liés. Cette
radicale sécheresse du style si prétentieusement revendiquée par
les auteurs actuels sert d'alibi à une pauvreté intérieure et
traduit en creux une sécheresse ontologique.
Il
existe une vérité
littéraire,
n'en déplaise à certains auteurs, à certains éditeurs, à
certains lecteurs. Une telle affirmation ne se confond pas avec une
attitude idolâtrique envers la littérature, toutes les formes
d'idolâtrie traduisent un manque d'enracinement, signe de
dépérissement de l'être. Il existe aussi une forme particulière
de responsabilité
des écrivains, responsabilité éthique ou plus exactement
ontologique, que les écrivains actuels ont tendance à oublier, se
faisant les complices d'une ambiance générale située sur le
versant dépressif et caractérisé par la perte du sens et le
cynisme. La névrose contemporaine est le symptôme d'une perte de
reliance symbolique, à laquelle contribuent des écrivains sans
scrupules et sans âme que seule animent l'affirmation tapageuse et
narcissique de leur petit moi ou le goût du lucre et de la célébrité
facile et médiatique.
Il
existe une vérité, vérité mystérieuse vers laquelle nous tendons
de tout notre être et que la littérature contribue à faire
émerger, « le style seul dit (cette) vérité ».
Critiquer le style actuel, en dénoncer le vide et l'insignifiance le
plus souvent ostentatoire et fière d'elle-même, ce n'est pas
simplement critiquer une certaine forme littéraire au nom de ses
propres goûts, c'est pointer un phénomène beaucoup plus profond et
qui engage tout notre être. Parler du « vide d'une littérature
qui fait semblant », ainsi que le fait Pierre Jourde, c'est se
situer résolument sur le plan ontologique, celui du mystère de
l'être qui mérite mieux que de simples poses et artifices ou que
des niaiseries ou des procédés stylistiques creux ou ronflants se
substituant à la recherche du sens dont la littérature peut être
un des authentiques artisans.
Jean-Daniel
Rohart.
Jean-Daniel
Rohart - Paris,
L'Harmattan, 2005, 246 pages.
Non, ce n'est pas un
livre de plus sur l'école, les faillites de l'enseignement et les
désarrois du professeur. L'essai de Jean-Daniel Rohart, enseignant
depuis trente ans, agrégé d'espagnol est un livre de réflexion
pédagogique et de témoignage. L'auteur connaît son sujet et
pourtant ne professe jamais. Loin des solutions « toutes
faites » et des miracles, il préfère à l'éducation, la
notion de « révélation » du savoir. Jean-Daniel Rohart
a la foi et nous la transmet. Il sait évoquer l'amitié
« profs-élèves », la découverte de l'autre, l'humeur
du professeur, des vertus essentielles pour « réenchanter »
selon ses propres mots. Un programme ambitieux mais un beau
programme. Le système est passé au crible : professeur, principal,
inspecteur. Jamais pourtant l'auteur ne critique le système ; il se
contente de s'interroger et par là-même de nous interroger.
Éric Poindron, RCA mag,
Reims.
Cet ouvrage fait plonger
le lecteur dans la vie d'un enseignant, confronté à tous les
problèmes que l'on voir régulièrement présentés sur les écrans
de nos télévisions, et toutes les questions sur la pratique de
l'enseignement. Le constat est sombre, et quand même porteur
d'espoir. Sombre, car toutes les tensions de la vie sociétale se
déploient en terrain clos à l'école (pertes des repères,
dévalorisation du père générant une crise de l'autorité et au
final la violence à la maison comme à l'extérieur etc.), et le
portrait est à ce point de vue saisissant : désespérance et
désenchantement des profs, confrontés à des situations de crise
auxquelles ils ne sont pas prêts ; pression, stress et anxiété
pour les élèves. Le nombre de troubles psychologiques est en
constante augmentation aussi bien chez les enseignants que les élèves
! Porteur d'espoir, car l'auteur défend la thèse que toute crise
débouche sur une remise en question, et un mûrissement.
L'enseignement devient ainsi un terrain de connaissance de soi, où
l' « ordinaire », la routine, sont souvent bousculés. Ce
livre, issu d'un passionné de la pédagogie, est à la fois très
universitaire par ses nombreuses citations, et plein d'humanité par
son aspect concret, de « terrain ».
Article
paru dans la Revue 3ème
Millénaire.
Face
à la tonalité morose et dépressive de la littérature pédagogique
contemporaine, ce livre paraîtra à bon droit original. En effet,
après plus de 30 ans d'enseignement de l'espagnol en divers lycées
de province, et sans cacher les difficultés qu'il a rencontrées,
l'auteur a intégralement gardé non pas ses illusions mais sa
passion d'éduquer. C'est pourquoi – et c'est l'objet de ses
diverses et nombreuses publications – il a le souci d'apporter sa
contribution à la sédation de la crise de l’École.
N'ignorant ni le déclin de la société globale, ni le blocage de la
transmission de la culture, mobilisant des courants de pensée qu'il
connaît bien – spécialement Don Bosco, Jung et Rogers – il
abandonne aux groupes de pression la récrimination sur l'absence de
moyens, la dogmatisation de préjugés idéologiques et le bavardage
démagogique ; il sait, quant à lui, que les problèmes tiennent à
l'occultation
des fins et des valeurs et à l'éclipse d'une éthique,
d'où procède la mauvaise qualité des relations entre les
partenaires de l'institution scolaire. Méfiant à l'égard d'une
action politique qui se prétendrait autosuffisante, il subordonne la
réactivation des motivations des élèves à une amélioration du
rapport enseignant-enseignés, c'est-à-dire à l'influence
contagieuse de personnalités rayonnantes, susceptibles de ranimer le
milieu, d'amener chacun à percevoir et à éprouver son éducabilité
et à retrouver un goût de vivre. C'est cela qui pourra
« réenchanter » l’École.
C'est donc à un
renouveau éthique,
à une « éthique polythéiste de l'éducation » (page
169) que convie Jean-Daniel Rohart avec alacrité, en recourant ici
particulièrement à Jung.
Sans doute
souhaiterait-on, ici ou là, une formalisation plus poussée mais on
doit surtout féliciter l'auteur de cet ouvrage tonique et
fortifiant, bien de nature à nourrir le goût de la réflexion et de
la recherche pédagogique.
Guy Avanzini.
« Attention
école, du signe désenchanté au Phénix enflammé »
Cet essai de
Jean-Daniel Rohart décompose les malaises de l’École avec une
lucidité qui risque de prendre à rebrousse-plumes les cohortes
d’autruches prisonnières de certitudes. Il s’adresse à ceux qui
voudraient encore accorder un sens à ce signe précieux, quasi
exclusivement associé au malaise par un système politico-médiatique
avide de simplifications sensationnelles ou clientélistes.
Courageusement,
même dans l’humour, ce livre tente d’orienter tous les acteurs
de l’éducation vers une réflexion éthique qui vole largement –
et heureusement ! – au-dessus des querelles boutiquières et
des caquetages de basse-cour où les dindons et les paons finissent
toujours, dans un silence gêné, par se joindre aux autruches
ensablées déjà évoquées.
On
y lit enfin que l’institution entière est clairement anxiogène et
pathogène :
-
Souffrance
des élèves, sur lesquels s’exercent les pressions parentales,
professorales et plus largement sociales, et qui ressentent plus ou
moins confusément l’entreprise de tri sélectif opérée par le
jeu des filières dont la finalité se réduit à la réussite ou
bien à l’échec professionnels.
-
Souffrance
des professeurs, vecteurs et outils parfois consentants de cette
violence économique, qui se voient persécutés par les élèves,
dénigrés par l’Opinion, abandonnés par une hiérarchie aveugle.
-
Déliquescence
vaniteuse de la formation, absurdité infantilisante de
l’inspection, ambitions restreintes des syndicats, discours
obsessionnels et pervertis autour de l’égalité des chances…
autant de facteurs aggravant le fameux « malaise » d’une
institution qui se prétend formatrice de l’individu et qui n’est,
à tout prendre, qu’un élevage d’élèves/alevins pataugeant
dans des bassins de formation dont les eaux troubles accentuent
encore la peur des requins régissant la Loi du Marché.
Cette
réduction de la fonction de l’École à une simple antichambre de
la sphère professionnelle fait donc l’objet d’une critique
précise et drôlement audacieuse.
Ainsi
le constat, d’autant plus affligeant qu’il est évident énoncé
au chapitre 8 : « Les études ne s’inscrivent pas dans
la vie, elles sont le prix à payer pour entrer dans la vie
professionnelle dans les meilleures conditions financières
possibles. Elles ont rarement un sens pour les jeunes actuels ».
Ce
désolant bilan se trouve balayé par une mise en chantier joyeuse
et originale de natures thérapeutique, intellectuelle et éducative.
Il était largement temps qu’un professeur fasse le chantier à
l’École. Et c’est en compagnie des Jung, Bachelard, Jaspers,
Nietzsche pour ne citer qu’une partie des membres de la sarabande
que Jean-Daniel Rohart élabore son réenchantement.
Ce
livre permettra, sinon une refonte (changer le moule ne changera pas
la nature du métal), moins encore des réformes (faussement
innovantes), mais peut-être de reconsidérer la vie et
l’éducation en proposant précisément de mettre de la vie dans
l’éducation.
Ambition
vitale, éthique loin des pitoyables discours doloristes,
nerveusement laïques ou orgueilleusement citoyens. Pour notre part,
nous souhaitons que ce chant ne soit pas celui d’un cygne, ni même
le dernier soupir d’un mammouth dépecé vivant, mais plutôt celui
d’un allègre Phénix archétypique.
Philippe
Cuisset, Professeur
de Lettres.
Chercheur,
mais aussi praticien passionné de la pédagogie, Jean-Daniel Rohart
est avant tout, comme le dit René Barbier dans la préface, « un
pédagogue ouvert à la surprise de la vie ». C’est son
expérience et cette passion, affinées et pourtant malmenées par
trente ans d’enseignement en France, que cet agrégé d’espagnol
essaie de nous communiquer à travers son livre. Rohart est
également un grand lecteur de tout ce qui traite de l’enseignement.
Son texte est émaillé de nombreuses références. Les unes,
fondamentales, signent les bases profondes de sa réflexion
philosophique et citent abondamment Jaspers, Jung et Rogers. Les
autres sont beaucoup plus en prise directe sur l’ici et maintenant
du sujet et tracent de paragraphe en paragraphe la résille que
Jean-Daniel Rohart tisse au fur et à mesure que sa pensée reflète
l’évidence de l’actualité pédagogique.
La
première partie de cet ouvrage est un constat de la situation de
l’enseignement aujourd’hui. L’auteur fait état d’une crise
sans précédent, déplore l’absence de caractère substantiel de
l’éducation et dénonce le consumérisme culturel. Il se
questionne sur le sens de l’action éducative caractérisée par le
manque de démarche éthique en réponse à toutes les demandes
urgentes (de la part des élèves, des parents, de la hiérarchie)
auxquelles les enseignants sont exposés. L’enseignant fatigué se
réfugie dans sa sphère privée ou est condamné au burn out. Car le
métier est devenu un métier à haut risque.
De
leur côté les élèves sont de plus en plus désinvestis et Rohart
qualifie d’extériorité le rapport qu’ils entretiennent avec
l’école et leurs études. Sentiment d’échec, tristesse,
troubles mentaux, absentéisme mettent en évidence le problème
social existant et sont autant de « symptômes du mauvais
fonctionnement du système scolaire français». Les relations
élèves-enseignants ne sont pas seulement conflictuelles mais
tendent à devenir malsaines.
Les
rapports entre les enseignants eux-mêmes semblent parfois refléter
le malaise ambiant. Devant des « collègues activistes [dont]
il faudrait partager toutes les valeurs », les autres « font
face en ordre dispersé », se réfugient dans le cours
magistral. Quant « aux chefs d’établissement…ils restent
apparemment attachés à la logique hiérarchique, avec ses codes et
ses règles immuables, désuètes et infantilisantes ».
Parlant
de l’institution, Jean Daniel Rohart dit qu’elle « est
malade des pièges et des embûches de la démocratisation…Après
avoir renforcé la sélection sociale et permis un système scolaire
à deux vitesses, le principe éthique de l’égalité des chances
dégénère en un égalitarisme
forcené et ostentatoire ».
Quant à la classe politique, elle n’a pas le désir de se poser
les vrais problèmes. Et Rohart de citer Vaneigem : « Les
mouvements de protestation…sombrent…dans la même…stupidité
que le pouvoir cacochyme qui les a provoqués .»
Ce
n’est pas sans amertume que Jean-Daniel Rohart aborde le problème
de la formation des enseignants. À part quelques exemples de stages
ou de publications dans ce domaine, la formation à l’aspect
psychologique et relationnel de la profession reste, selon lui,
« frileuse…voire inexistante... [Or] elle se pose de
manière urgente ». Selon l’auteur elle devrait être
individualisée et centrée sur la personne de l’enseignant pour se
prolonger dans une formation continuée permettant une recherche
personnelle, aidée par l’institution.
Et en
conclusion de cette première partie, Rohart fait un plaidoyer pour
une éthique rogérienne et jungienne de l’éducation. « Faire
sauter les barrières » des particularismes et du sectarisme.
Une « Éducation
postmoderne et polythéiste…en
rupture avec l’éducation de la Modernité…caractérisée [selon
Foucault] par l’attitude du surveiller
et punir »,
voici ce qu’il préconise.
La
deuxième partie de ce livre est autobiographique. L’auteur nous y
indique que, faute de formation, sa pensée en matière d’éducation
s’est élaborée de manière autodidacte. Son message final nous
invite à réenchanter le monde en « désidéologisant »
l'École, à… « laisser la vie entrer à l’école ! »
Françoise
Ducroux-Biass.
|
|