|
|
- « Faut-il être chrétien pour appliquer le
système préventif (de Don Bosco) ? »
- « Il n’est pas de pédagogie réussie, si
elle n’est pas traversée par l’éthique et l’éthique de l’ agapè ».
Mais cette : « Mise en œuvre de l’agapè (se fait) dans la
contingence, l’aspect partiel et le compromis des situations humaines complexes »
Chantal Roche :
Bonjour à tous chers amis auditrices et auditeurs, vous connaissez le principe
de notre émission qui est : « la parole aux auditeurs » et,
aujourd’hui, nous avons à nos côtés l’un de vous qui veut nous faire partager
sa passion. Sa passion pour l’éducation des jeunes, et l’éducation des jeunes,
à travers son métier d’enseignant : Jean-Daniel Rohart.
Jean-Daniel
Rohart : oui.
CR :
Bonjour.
JDR :
Bonjour.
CR : Merci d’être venu nous faire partager cette
passion. Alors, passion des jeunes, passion de l’éducation, passion de votre
métier d’enseignant, puisque vous êtes professeur ?
JDR : Oui,
cela fait 30 ans ! Donc, vous voyez, on peut dire qu’il s’agit d’une
vieille passion.
CR :
Professeur de…
JDR :
d’espagnol.
CR :
d’espagnol, à Reims, je crois…
JDR : A
Reims, oui, oui.
CR : Est-ce
que cette passion de l’éducation des jeunes vient toute seule ou bien est-ce
que vous la cultivez ?
JDR : Oui,
oui, une telle passion se cultive, à mon avis. Si vous voulez, cette passion
est née de difficultés. J’ai commencé à enseigner dans les années 76, en
banlieue parisienne. C’était dans une ZUP et je n’avais pas été vraiment formé
à une telle situation. Il a donc fallu que j’essaie de comprendre ce qui se
passait, comprendre mes difficultés, et j’avais le désir de faire en sorte que
mon métier ait un sens, que je vienne en classe le sourire aux lèvres,
on va dire, et non pas à reculons. Que mon métier ne soit pas uniquement un
gagne-pain, je voulais même que la rencontre avec les élèves puisse
éventuellement s’accompagner de plaisir.
CR : Alors,
vous vous êtes inspiré de quoi pour arriver à ce souhait d’être présent et de
vibrer et non pas de venir avec des semelles de plomb ?
JDR : Eh
bien, j’ai beaucoup lu, j’ai beaucoup
lu, il y a une part livresque dans mon parcours personnel. J’ai lu notamment Don BOSCO, ou plutôt un livre sur Don BOSCO, écrit
majoritairement par des salésiens de Don BOSCO.
CR :
Pouvez-vous préciser pour nos auditeurs ?
JDR : Oui,
oui,
CR : Cela
serait bien d’expliquer un petit peu. Don BOSCO vivait au XIXème siècle en
Italie ?
JDR : Oui c’est ça, dans le Nord de l’Italie et si
vous voulez, le public de…, on va dire le public, mais c’est un mot qui n’est
pas très beau. Parlons d’élèves ou de jeunes, plutôt, les jeunes auxquels Don
BOSCO avait à faire ressemblent un peu à ceux auxquels nous avons à faire
maintenant. C’est à dire, que, par delà le temps, ce que disait Don BOSCO est,
à mon avis, tout à fait applicable au contexte actuel.
CR : Et
qu’est-ce qu’il disait ?
JDR : Pour
résumer, il parlait de… (j’espère ne pas écorcher ce mot italien) de l’Amorevolezza.
C’est une forme d’amour, si vous voulez. Don BOSCO s’inspirait de Saint Paul,
de la charité paulinienne. Il disait qu’il faut que les élèves soient aimés et
sachent qu’ils sont aimés, mais en même temps, il était très dur. Il posait un
cadre. Sa pédagogie n’était pas du tout “fleur bleue”, mais il disait que les
élèves doivent se sentir aimés de manière inconditionnelle, pour parler
comme Carl ROGERS.
CR : Donc,
vous vous êtes inspiré de ces textes ?
JDR : Oui.
CR : Vous
les avez un peu fait vôtres. Et comment est-ce que cela se traduit alors ?
Parce qu’on peut lire beaucoup de choses, mais dans l’application pratique…
JDR : Oui,
oui, oui…
CR :
L’éducation des jeunes qui assistent à vos cours, dans vos classes, s’en
trouve-t-elle changée ?
JDR : Oui,
je l’espère, en tout cas ! Don BOSCO n’a pas écrit énormément. Pour
répondre à votre question précédente, je l’ai découvert à travers l’œuvre de
Xavier THEVENOT, lequel était un théologien moral et salésien de Don BOSCO
lui-même. Cet auteur a beaucoup écrit sur l’éducation, des écrits qui m’ont
beaucoup éclairé. Nous avons
un peu correspondu. Ses lettres constituèrent un encouragement pour moi, une
aide à la fois intellectuelle, humaine et spirituelle.
CR : Alors
“salésien”, quand vous dites “salésien”, c’est de la famille de…
JDR : Saint
François de SALE.
CR : Voilà,
pour qu’on voie un peu la filiation. Donc, comme Don BOSCO, finalement ?
JDR :
Voilà.
CR : C’est
toujours la même parenté ?
JDR : C’est
Don BOSCO qui a puisé aux sources salésiennes. Moi, jusqu’à il y a encore peu,
je ne connaissais pas Saint François de SALE,
je le connaissais à travers Don BOSCO, si vous voulez, puisque ce dernier se
situe dans cette ligne “salésienne”.
CR : Mais,
c’est un peu la même famille ?
JDR : Voilà, c’est ça ! Oui, oui, et après,
si vous voulez, dans mon parcours de formation, il y a eu Carl ROGERS.
Il me semble important de préciser
cela, parce que Carl ROGERS est
quelqu’un - un psychologue américain - qui n’est pas chrétien, mais qui parle
de l’Acceptation Inconditionnelle d’Autrui,
laquelle est très très proche de l’Amorevolezza. Excusez-moi, j’écorche
ce mot, mais on l’aura compris, c’est une forme d’amour, comment dire ?,
une manière de considérer les élèves comme des personnes et pas
uniquement comme des élèves et ce, même s’ils sont faibles dans la matière que
l’on a choisi d’enseigner, agités et inattentifs. Les accepter comme ils
sont. Enfin, essayer, bien sûr, de les faire progresser, mais voyez, ne pas les
réduire à leurs notes, à leurs mauvaises notes et les considérer comme des
personnes, que notre rencontre ait un sens et pour eux et pour nous et que, je
le répète, nous puissions tous y trouver aussi du plaisir.
CR : Donc,
je vous rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, que nous sommes à côté de
Jean-Daniel Rohart, qui nous fait partager sa passion pour l’éducation des
jeunes et l’éducation des jeunes à travers son métier d’enseignant.
Jean-Daniel,
vous étiez en train de nous parler de Don BOSCO et de Carl ROGERS.
JDR : Oui.
CR : Est-ce
que ces deux auteurs que vous avez travaillés vous ont éclairé d’une
manière pratique et pas seulement théorique, dans l’approche de vos
élèves ?
JDR : Oui,
oui.
CR : Est-ce
que vous pouvez nous donner un ou deux exemples tout simples ?
JDR :
Curieusement, si vous voulez, j’étais, je ne peux pas vraiment dire “salésien”,
mais rogérien, sans le savoir. C’est en lisant Carl ROGERS que j’ai eu
confirmation de mes intuitions. Par conséquent, mon parcours de “formation”
n’est pas un parcours d’abord livresque, le parcours livresque, il vient après.
Alors en classe, comment cela se traduit-il ? Eh bien, comment vous
dire ? D’abord, il convient d’essayer de ne jamais “prendre les élèves en
grippe”.
CR : Cela
vaut mieux, effectivement !
JDR : Mais cela
peut être dur et ne va pas de soi, car vos élèves vous en font voir
parfois ! Il convient de ne pas avoir une sorte de… comment dire… ?
CR : Il
faut un parti pris positif au départ.
JDR :
“Positif”, cet adjectif me fait penser à un mot très très cher à Carl ROGERS et
que n’aurait pas désavoué Don BOSCO, il me semble : c’est la confiance.
Voyez-vous, ça, c’est capital. Quand vous faites confiance aux élèves, eh bien,
vous les responsabilisez. Après, on peut être exigeant, à condition toutefois
qu’ils sachent qu’on leur fait confiance et qu’on les aime, même si cela paraît
un petit peu… On éprouve une certaine gêne, une certaine pudeur, à dire que
l’on aime les élèves. On éprouve une certaine retenue. Mais pourquoi pas les
aimer, après tout ?
CR : Mais
la confiance doit être mutuelle ?
JDR : Oui,
bien sûr ! Mais, c’est au professeur de créer un climat de confiance, et
ensuite ce climat s’établit pour ainsi dire naturellement. Mais cela nécessite
parfois un long travail préalable !
CR : Est-ce
que vous y arrivez ? Parce que les élèves, on les a une année, pas très
souvent plus. Est-ce que, en une seule année, on arrive à faire ce long travail
de confiance, de respect mutuel ?
JDR : Mais
oui, parce qu’on les a une année, mais certaines fois on les retrouve. Personnellement,
je suis resté quelquefois 7 ans, 10 ans dans le même établissement. Les élèves
parlent entre eux. Ils nous connaissent par ouï-dire. Le téléphone arabe
fonctionne bien, dans l’enseignement confessionnel comme dans l’enseignement
public, je suppose ! Moi, j’ai eu des élèves qui me parlaient dans les
couloirs, des élèves que je n’avais pas en classe. Il y en a qui demandent à
assister à mes cours, alors qu’ils ne font pas partie de la classe.
J’ai eu aussi
des difficultés, bien sûr. Je ne veux pas le nier. L’infaillibilité n’existe
pas plus en éducation que dans les autres domaines de la vie sociale et de la
vie tout court. Des
problèmes de discipline, comme on dit. Je ne veux pas présenter les choses de
façon…
CR : Rien
n’est jamais idyllique.
JDR :
Voilà ! Ce n’est pas idyllique, mais on peut établir des rapports
confiants et constructifs dans la
durée, parce que l’on appartient à un établissement, on a donc une image
auprès des élèves. Les élèves savent, voyez, même si on ne les a d’abord qu’une
année, parfois on les retrouve plus tard une deuxième année, s’ils redoublent
et même s’ils ne redoublent pas. On peut les avoir d’abord en seconde et puis
les retrouver en terminale. J’ai vu des élèves qui étaient un peu critiques
vis-à-vis de moi et de mon enseignement, en classe de seconde, et en
terminale, ils me disaient : « on voit maintenant ce que vous
vouliez faire ».
CR : Donc,
c’est sur la durée ?
JDR : Oui,
oui, bien sûr.
CR : C’est
donc sur la durée qu’un professeur peut faire passer un message de confiance
mutuelle ?
JDR : Oui,
en effet.
CR :
Qu’est-ce que l’on pourrait dire encore d’une manière pratique de votre passion
d’enseigner ? Les jeunes… aujourd’hui sont … par rapport aux débuts de
votre carrière ?
JDR : Ils
ne sont pas pires, voyez-vous, parce que, comment dire ? Il nous faut désormais gagner leur
confiance, mais avant, nous, on avait peur. Moi, j’avais peur de mes
« profs ». Ce n’était pas vraiment une forme de respect. C’était une
forme de crainte. Donc, on ne bougeait pas. Maintenant, il faut gagner la
confiance des élèves. Mais lorsqu’on l'a gagnée, alors on a de vrais rapports,
voyez-vous, parce que c’est gagné de haute lutte. Ce n’est pas dans la crainte,
et cela change tout.
CR : Donc,
c’est un respect mutuel, aussi.
JDR : Oui, bien sûr. Oui, il faut aussi avoir de
véritables exigences. Il y a des choses totalement inacceptables d’un point de
vue à la fois éthique
et pédagogique.
CR : Pour
qu’existe un respect mutuel
professeur/élèves (surtout élèves en groupe) qu’est-ce qu’il faut comme
ingrédients?
JDR :
Ha ! Comme ingrédients ? Il n’y a pas de recettes toutes faites, mais
lorsque les élèves sentent que l’on a du plaisir à venir, que l’on arrive avec
le sourire, qu’on les accepte comme ils sont, qu’on est prêt à les aider
à progresser et que, dans le même temps, on est exigeant, eh bien, petit à petit, les rapports évoluent
dans un sens favorable. Il peut y avoir des problèmes, il y en a, j’en ai
encore, hein, j’en ai encore, mais je
peux affirmer, en m’appuyant sur une longue expérience enseignante, que les
choses finissent toujours par s’arranger, même quand il y a des conflits,
voyez-vous, parce qu’il y en a, naturellement, pourquoi le nier ? La
relation éducative actuelle est assez souvent placée sous le signe de l’angoisse :
angoisse des parents, angoisse des élèves, angoisse des professeurs, angoisse
en partie légitime des chefs d’établissement, toutes ces formes d’angoisse
s’entretenant mutuellement dans certains cas.
CR : C’est
applicable justement… parce que vous parlez de conflits, alors la qualité de la
relation éducative
dépend-t-elle des lycées ? Dépend-t-elle des collèges ? Dépend-t-elle
des villes ? Des quartiers ? Est-ce que cette façon d’enseigner est
applicable partout ?
JDR : Ah
ça, je ne sais pas !
CR : Avec
votre expérience personnelle, parce que vous avez enseigné dans différents
établissements et dans différentes villes ?
JDR : Dans
des établissements plus ou moins difficiles, en effet. J’ai désormais la chance
d’être dans un établissement rêvé pour tenter de faire ce que je veux faire et
vivre, le plus sereinement qu’il est possible, ma “philosophie” de l’éducation.
Il y a des établissements difficiles, c’est certain, et là il faudrait des
“profs” hors pair, des “profs” qui auraient été spécialement formés pour faire
face à des situations aussi difficiles qu’inattendues. Je ne veux pas être trop
polémique, mais il faudrait vraiment former les enseignants (les chefs
d’établissement et les inspecteurs)
aux difficultés qu’ils vont être susceptibles de rencontrer, surtout dans
certaines banlieues, dans certains coins.
CR : Et
vous la voyez comment cette formation ?
JDR : Eh
bien, je serais malheureusement assez
critique en ce qui concerne l’actuelle formation des maîtres.
CR : Sans
être critique, mais en étant positif, qu’est-ce que vous suggérez ? Parce
que c’est toujours facile de
dire : « il faudrait que… »
JDR : Oui, vous avez raison, il faut être positif. Eh
bien, je pense que la formation « officielle » - on va l’appeler
comme ça - devrait davantage attirer
l’attention des futurs enseignants sur l’aspect relationnel et tenter de
les armer psychologiquement pour les aider à vivre le mieux possible les
conflits qui
risquent d’émailler leur vie professionnelle.
En France, notre système d’enseignement possède des points
forts. Les professeurs connaissent généralement très bien la matière qu’ils
enseignent, l’espagnol, les mathématiques, l’économie, l’histoire... Il s’agit
là d’un point fort qu’il faut absolument conserver. La bivalence me semble à
proscrire. Mais je pense que pour améliorer la formation, pour qu’elle soit
adaptée au contexte actuel qui est difficile, il faudrait sensibiliser les
jeunes enseignants à l’aspect relationnel, voyez-vous et là, peut être Don
BOSCO et Carl ROGERS, entre autres, pourraient être utiles. En tout cas, il
faudrait les sensibiliser à l’aspect relationnel et les y préparer, parce que
c’est difficile, c’est difficile.
CR :
L’enseignement reste-t-il toujours le
plus beau métier du monde ?
JDR :
(Rires) Pour moi, oui ! Il y a 30 ans que j’enseigne, et je suis toujours
content d’enseigner. Je ne regrette pas d’avoir fait ce choix, mais il y a
aussi des professeurs qui sont déstabilisés psychologiquement.
L’enseignement est un beau métier, mais qui mériterait d’être… Il faudrait
accompagner les enseignants, les aider sur le plan de la formation, car
enseigner aujourd’hui, c’est difficile et parfois dangereux sur le plan de sa
santé mentale. Les chercheurs spécialisés dans l’étude du vécu intérieur des
enseignants, Ada ABRAHAM,
par exemple, ont bien mis en évidence ce caractère de dangerosité. Il ne faut
pas mentir, voyez-vous. C’est un beau métier, mais c’est difficile, difficile.
CR : Et
vous me disiez hors antenne que les parents étaient de plus en plus conscients
des difficultés rencontrées par les professeurs ?
JDR : Oui,
en effet. Je lisais récemment un article tiré de Aujourd’hui en France
(je lis beaucoup la presse quotidienne pour “prendre la température” de l’Ecole
et m’informer de ce qui se passe ici ou là). Le titre était : Violence
scolaire, absentéisme. Les parents en première ligne.
Cette mobilisation nouvelle
des parents me semble intéressante, parce que les difficultés actuelles :
la violence, le côté tragique même de certains évènements, au fond, vont peut
être permettre - en tout cas, je l’espère - la construction de nouveaux
rapports entre les parents, les professeurs et les membres de la
hiérarchie : chefs d’établissement et inspecteurs.
Moi, en tout
cas, je reste optimiste. L’enseignement est un beau métier, difficile, et il y
a des choses à faire, sans aucun doute.
CR : C’est
pourquoi, vous avez intitulé votre
dernier livre : Comment réenchanter l’école ?
JDR :
Oui ! c’est ça. Et avant, il y a : La vie et l’éducation.
La vie et
l’éducation. Suivi de : Comment réenchanter l’école ? Car, je pense que ce réenchantement est
possible, en effet.
CR :
Jean-Daniel Rohart, je vous remercie
beaucoup d’être venu nous expliquer votre passion pour l’enseignement comme ça
très rapidement. Donc, je conseille à ceux qui voudraient plus de détails de se
référer à votre livre : La vie et l’éducation. Suivi de : Comment
réenchanter l’école ? L’Harmattan, décembre 2005.
Et c’est sur ce
titre que je vais vous laisser, chers amis auditrices et auditeurs, et je vous
dis : « A dans quelques semaines ».
[8] ROHART Jean-Daniel.- Quid de la Non-Directivité rogérienne ? Contribution à une
nouvelle éthique de l’action enseignante. Publié par l’Association VOIES -LIVRES / SE
FORMER + S.16, 23 pages, 1992.
Et : Action éducative et éthique (Carl ROGERS,
Carl Gustav JUNG et l’éducation). Publié par l’Association VOIES-LIVRES /
SE FORMER + S.67. 16 pages, Juin 1997.
Adresse : Association VOIES-LIVRES 13 quai Jaÿr 69009 LYON Tél. : 04
78 83 53 83.
|

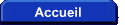



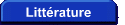






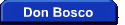



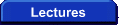
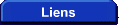
 Emission de radio du 9 février 2006
Emission de radio du 9 février 2006