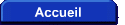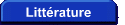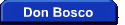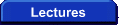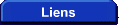|
Paru
dans la revue rogérienne ACP
Approche Centrée sur la Personne. Théorie
et Pratique.
ACP
Pratique et recherche n°10 pp.85-87, déc.2009.
Carl Rogers et
l’action éducative,
Coordonné par Jean-Daniel Rohart
Compte-rendu
de lecture de Paul Emmanuel Gross
Cet ouvrage
collectif propose de s’interroger sur la pertinence de la pensée
et de l’attitude rogériennes dans le contexte de l’école
actuelle. Plusieurs acteurs du système éducatif y apportent des
regards complémentaires, tous motivés par la conviction que
l’Approche centrée sur la personne peut contribuer à humaniser
l’école et donner un sens à l’expérience scolaire.
Un premier chapitre
présente au lecteur les fondements de la démarche liée à
l’Approche centrée sur la personne, ses applications ainsi que les
éléments de la pensée de Rogers. Les concepts de base y sont
présentés dans leur complexité et illustrés d’exemples pour en
faciliter la compréhension.
Le chapitre suivant
propose une discussion et analyse du modèle pédagogique rogérien.
S’agit-il de la dernière des utopies pédagogiques ?
Tout en reconnaissant la cohérence du paradigme, l’auteur
s’interroge sur l’adéquation du modèle avec l’école de
demain et insiste sur l’inspiration humaniste de Rogers, sa
confiance envers les enseignants et le respect de la personne de
l’apprenant.
Le troisième
chapitre est un texte de Carl Rogers, L’élève au centre des
apprentissages, dans lequel le psychologue américain invite à
une véritable démocratie en éducation en comparant les
caractéristiques de l’enseignement traditionnel dans son rapport
au pouvoir avec les conditions d’un apprentissage centré sur la
personne. Les implications politiques de cette optique éducative
sont telles qu’elles bouleversent autant les enseignants (perte de
pouvoir) que les apprenants (prise de responsabilité) et annoncent
un véritable renouvellement de la politique éducative.
Un quatrième
chapitre propose quatre témoignages d’enseignants actuels qui
tentent de mettre en acte cette anthropologie rogérienne dans leurs
pratiques d’enseignement.
En quoi l’attitude
rogérienne contribue à la gestion de la crise de l’école ?
Dans ce cinquième chapitre, Jean-Daniel Rohart reprend l’idée
que, loin d’être une méthode, l’Approche centrée sur la
personne en éducation désigne d’abord une certaine manière
d’être « qui plonge ses racines dans un sentiment
indéfectible de confiance et d’amour envers des élèves
considérés comme des personnes ». À ce titre, il situe Carl
Rogers dans le courant de la philosophie personnaliste, qui
expliquerait la modernité de ses propos. L’attitude « rogérienne »
propose de la prévention et de la réparation aux élèves blessés
par une institution scolaire qualifiée de « malade »,
elle fait renaître un sentiment d’estime d’eux-mêmes, elle
amène, selon l’auteur, un nouveau modèle identificatoire proposé
par les adultes en réponse aux nouvelles attentes des élèves et
contribue par là à la résolution de la crise que connaissent les
modèles traditionnels d’autorité. Cette attitude suppose pour
l’enseignant un lent travail d’attention sur soi afin de rester
lucide sur les sentiments contradictoires émergeant de la pratique
enseignante. L’auteur souligne l’importance d’une certaine
maturité psychologique à développer et conclut à la nécessaire
formation initiale des enseignants à la démarche rogérienne.
La réflexion se
prolonge dans le sixième chapitre par le témoignage professionnel
et les interrogations de Marie Kilborn sur les difficultés à mettre
en œuvre l’Approche centrée sur la personne. Elle aborde la
question de la pertinence des préceptes de Rogers – empathie,
considération positive inconditionnelle et congruence – lorsqu’ils
sont proposés aux enseignants et conclut à leur actuelle nécessité
pour préparer les adultes créatifs de demain.
Le septième
chapitre propose d’accompagner les enseignants et de poser notre
regard sur les moments de doute et de désirs de changement qui
peuvent apparaître durant la carrière de l’enseignant. Il y est
fait mention de structures d’aide à la construction de la personne
enseignante. Là encore, l’auteur de l’article conclut
qu’outre la maîtrise de la didactique et de la pédagogie,
enseigner implique chez l’enseignant une dimension plus personnelle
qu’une analyse de pratique, et que des lieux de paroles devraient
être considérés.
Le chapitre suivant
porte sur la notion d’empathie inscrite dans la formation
enseignante. Dans un contexte actuellement difficile, les remarques
moralisatrices et reproches adressés aux élèves sont autant de
blessures narcissiques qui n’apportent pas d’amélioration de la
situation. L’enseignant doit proposer une autre réponse, nous dit
l’auteur, et, ce faisant, doit s’entraîner à l’empathie,
attitude qui semble être la plus appropriée au contexte relationnel
actuel. Il est donc nécessaire de sensibiliser les enseignants
durant leur formation à cette dimension éthique.
Dans un même
esprit, il convient de redéfinir le rôle et la fonction de
l’inspecteur. C’est la contribution du neuvième chapitre de cet
ouvrage. La crise de l’institution scolaire actuelle amène les
enseignants et les inspecteurs à changer le mode de leur relation.
L’auteur propose une vocation nouvelle à l’inspecteur :
accompagner l’enseignant dans l’élucidation de sa quête
d’identité professionnelle. Il souligne la modernité de la pensée
de Rogers comme une proposition de développement de l’inspection.
Le dixième
chapitre nous invite à entrer au cœur même de l’Approche centrée
sur la personne exercée tant dans le cadre psychothérapeutique,
lors d’intervention en entreprise qu’en situation d’enseignement.
Au travers de plusieurs exemples tirés de la pratique, les auteurs
tentent de nous faire percevoir ce « chemin d’ouverture
proposé à chaque être humain ».
Un dernier chapitre
s’interroge sur le lien existant entre l’Approche centrée sur la
personne et la médiation et met en parallèle les différents
éléments des deux approches. Les points de convergence et les
éléments de distinction qui y sont étudiés amène l’auteur à
poser une certaine complémentarité.
En conclusion de
l’ouvrage, Jean-Daniel Rohart relève la diversité et l’unité
des enjeux d’une telle approche. Il lie ces onze contributions par
un problème général : quel sens donner aux pratiques
éducatives ? Sont-elles des facteurs d’aliénation ou de
liberté ? L’approche rogérienne apporte à cette question
une éthique personnaliste, elle propose une relation fondée sur la
confiance et non sur un système. Si la mission politique de l’école
est de favoriser la personne dans sa tendance à l’autonomie, « ce
serait alors la grandeur de l’école que d’instituer ce qui
pourrait la destituer, c’est-à-dire la liberté des sujets
cognitifs ».
|