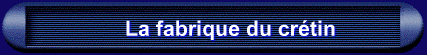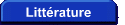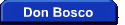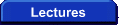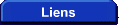|
|
Des auteurs comme celui de
La fabrique du crétin,
par delà la pertinence, d’ailleurs très problématique, de leurs
analyses, manquent généralement d’empathie envers les
enseignants et envers les élèves qui s’écartent de leur
représentation de l’élève idéal. Leurs témoignages risquent,
par ailleurs, de nourrir le désarroi et l’inquiétude des parents
d’élèves, et de leurs grands-parents.
Il est des livres, parfois
géniaux, qui déroulent sous nos yeux plus ou moins émerveillés,
le spectacle désolant des chemins qui ne mènent nulle part. Tel est
un peu le cas, toute comparaison gardée, bien évidemment !,
dans le domaine plus restreint de l’École et de l’éducation,
de La fabrique du crétin.
Ayant refermé ce
livre-pamphlet, le lecteur se demande : « que nous
reste-t-il à faire face à un bilan aussi pessimiste et désespéré
de la situation de notre École ? » Dresser de tels
tableaux n’est-ce-pas, comme on dit familièrement, “en remettre
une couche” ? Plusieurs livres ont déjà fait le même
constat et dressé le même bilan, alors à quoi bon en rajouter un
autre à chaque nouvelle rentrée scolaire ?
Le faire, n’est-ce-pas renforcer la novembrite et la
morosité ambiantes ? N’est-ce-pas encourager le
découragement, rendre plus difficile le réenchantement de notre
École ?
Les humanistes, ceux qui
ont une représentation “humaniste” de l’École, comme Alain
Finkielkraut, semblent ignorer, quelles que soient par ailleurs leurs
qualités intellectuelles et le plaisir que l’on éprouve à
écouter Réplique, sur France Culture, le contexte social et
politique. Mettant l’accent de manière exclusive sur la Culture,
ils ont tendance à oublier le destinataire, l’élève qui est
aussi une personne qui a besoin d’une éducation morale et doit
être respecté en tant que personne et non pas réduit à ses seules
performances intellectuelles.
En France, nous manquons
singulièrement d’esprit de tolérance envers ceux qui n’adhèrent
pas de façon inconditionnelle à la culture humaniste et n’en
partagent pas tous les présupposés et toutes les valeurs.
Bruno Bettelheim écrivait à ce sujet : « La liberté
exige non seulement l’égalité des chances, mais la diversité
des choix possibles. Elle implique que l’on soit tolérant
à l’égard de ceux qui ne se conforment pas à des normes qui,
tout en étant culturellement désirables, ne sont pas essentielles à
la survie de la société. Notre société actuelle manque souvent de
tolérance ».
Ces auteurs, tenants
inconditionnels de la culture humaniste, donnent de l’École une
vision partielle, très partielle et partiale. Ils ne rendent pas
justice de tout le travail et de toutes les innovations sérieuses
de collègues qui, dans tout l’hexagonal, tentent de s’adapter
avec courage à un contexte scolaire difficile et réalisent parfois
des prouesses. Ils jugent l’École d’aujourd’hui en la
comparant à l’École d’hier, qu’ils idéalisent plus que de
raison. Comme René Guénon, ils sont nostalgiques d’une époque
qui n’a jamais vraiment existé, si ce n’est dans leur
imagination et leurs rêves, comme d’autres s’inventent un dieu
pour y croire ensuite !
Une
nouvelle façon d’aborder la Crise de l’École :
C’est, quoi qu’il en
soit, une nouvelle façon d’aborder la crise de l’École que je
voudrais tenter de mettre en place. Car, alimenter le discours
ambiant, les jérémiades, c’est alimenter l’inquiétude et la
morosité ambiantes. Ce n’est pas faire œuvre utile.
Demandons-nous plutôt si les crises, pour désagréables et
déstabilisatrices qu’elles sont, (tout comme le sont les conflits
et la violence) ne sont pas nécessaires et si les crises, les
conflits et la violence étaient en effet nécessaires, ainsi que le
sociologue Michel Maffesoli l’a montré, notamment dans un petit
article auquel je me réfère ici et qu’il a intitulé : « Du
bon usage de la violence » ?
Il y a deux façons
d’aborder la question de la crise de l’École, car on ne peut
plus désormais nier qu’il y ait crise et se réfugier derrière
des slogans aussi généreux que creux. Cette crise est d’ailleurs
européenne et les chiffres plutôt alarmants : 16 à 25 % des
élèves européens seraient en difficulté, 160 000 d’entre eux
quittant le système scolaire sans diplôme, selon une étude
réalisée par L’European Association for Special Education.
La première façon de
vivre la « crise » consiste à céder à l’angoisse et
au désespoir qu'elle fait naître en nous, et Dieu sait combien il
est facile par temps de crise, justement, de céder à cette
tentation, aidés en cela par le discours ambiant et médiatique. Il
n’y a qu’à suivre sa pente naturelle. Mille arguments, mille
souffrances peuvent alimenter cette posture existentielle et loin de
moi l’idée de jeter la pierre à ceux qui cèdent au pessimisme.
La deuxième façon de
considérer les crises, c’est de les analyser comme des symptômes
qui, certes, traduisent un état maladif passager de notre société
et de notre École et qui entraînent des souffrances. Mais ces
souffrances peuvent aussi avoir un sens
et elles peuvent être considérées comme les prémisses d’un
changement en profondeur, le signe qu’un changement de paradigme et
d’organisation, changement désormais à l’ordre du jour, tant
dans le domaine scolaire, que dans tous les autres domaines qui sont,
eux aussi, entrés en crise : l’agriculture,
l’économie, la santé, la politique, l’administration, etc.
La vie individuelle et la
vie des sociétés et des institutions est constitutivement et
normalement traversée de crises successives. C’est l’affrontement
avec ces crises, la victoire, d’ailleurs toujours provisoire, sur
ces crises, qui permet d’abord de survivre, mais aussi de
progresser sur les plans existentiel, éthique et ontologique.
Et ce qui est vrai pour
l’École et pour les autres institutions l’est aussi pour les
individus, pour tous les acteurs de la relation éducative au sens
large : les professeurs, les élèves, les chefs
d’établissements, les inspecteurs, etc.
La question est donc, non
de céder au catastrophisme, d’ajouter sa note au concert de
lamentations, mais de prendre la crise de l’École à bras le
corps, non pour sortir de la crise, comme le titre de mon livre le
laisse abusivement entendre,
mais pour “gérer” la crise comme l’on dit aujourd’hui, en
employant ce vilain terme appartenant à l’économie, laquelle
règne même sémantiquement sur nos consciences et sur notre
langage.
L’attitude que
j’esquisse nécessite un certain courage et beaucoup de confiance
et de foi, les deux mots étant d'ailleurs liés étymologiquement
dans la spiritualité juive (la Thora).
Puissent ces remarques et
mes livres contribuer à faire naître en nous ces deux sentiments :
le courage et la confiance. Mais, me direz-vous, peut-on aller seul
et en ordre dispersé au combat ? Et je ne parle pas ici des
croques en jambe que se font les divers acteurs de la relation
éducative, du haut en bas de la hiérarchie ! Au lieu d’unir
leurs efforts, ils se nuisent parfois mutuellement. Plagiant Isabelle
Filliozat,
on pourrait dire que l’École d’aujourd’hui : « ne
peut plus se permettre le gaspillage d’énergie et de créativité
dans les jeux de pouvoir. L’heure est à la mise en commun des
compétences, aux dynamiques de réseaux ». À ce que j’ai
moi-même appelé,
empruntant l’expression et l’idée à André de Peretti, des
relations de compagnonnage entre toutes les personnes engagées, à
un titre ou à un autre, dans une relation éducative. Dans un
ordre d’idées assez proche, certains auteurs parlent de la
constitution de réseaux et d’un changement radical dans les formes
d’organisation de l’action collective et dans les modes de prise
de décision.
Je pense, en effet, que le
nouveau paradigme éducatif devrait se caractériser par la
solidarité et la fraternité entre professeurs, élèves,
parents d’élèves, chefs d’établissements, inspecteurs et même
recteurs d’académies, si l’on estime que la tâche de cet
administrateur un peu particulier doit être aussi éducative et pas
seulement politique et gestionnaire ou, en tout cas, qu’elle doit
viser à créer les conditions à la fois matérielles et
psychologiques les meilleures à la réalisation de la tâche
éducative de ceux qui interviennent directement à ce niveau là.
Les enseignants doivent, certes, puiser le nécessaire sentiment
de sécurité en eux-mêmes, grâce à un travail de formation
continue et à un travail sur eux-mêmes. Le meilleur outil d’un
enseignant actuel est, sans conteste, une personnalité équilibrée,
la faculté qu’il possède de s’impliquer avec calme, humour et
confiance dans le présent,
en s’appuyant sur les points forts de sa personnalité, afin de
construire avec ses élèves une relation qui fasse sens, et pour lui
et pour eux. Mais, les professeurs doivent aussi impérativement
recevoir une aide efficace de la part de l’Institution qu’ils
servent.
L’action des chefs
d’établissements (principaux de collèges et proviseurs de
lycées), et des inspecteurs devrait favoriser les conditions les
meilleurs possibles à la réalisation de cette tâche difficile, au
lieu de la compliquer par des tracasseries diverses et des jeux de
pouvoir désormais dépassés ! La pensée de Carl Ransom Rogers
se présente alors tout naturellement à nous,
ainsi que celle de Don Bosco.
Je pense personnellement
que de telles pensées devraient alimenter les programmes de
formation de tous les
acteurs de la relation éducative car, pour entrer dans ce nouveau
paradigme qui se profile à l’horizon,
il nous faut préalablement y avoir été préparés et formés. Et
au lieu de suspicion entre nous, c’est de partage de l’expérience
dont nous avons besoin, chacun étant, ou pouvant devenir pour
l’autre, un agent de formation et bénéficier à son tour de
l’expérience de ses collègues et de ses supérieurs
hiérarchiques.
Jean-Daniel Rohart.
|