|
|
Extrait
Dans
le contexte actuel de notre société qui, il est vrai, peut aisément
faire naître et entretenir un profond désespoir, ainsi que la
confusion des esprits, il existe plusieurs attitudes possibles
correspondant à plusieurs camps.
On pourrait distinguer très schématiquement :
Le
camp de la pesanteur et le camp de la légèreté.
On
peut catégoriser les diverses attitudes possibles face à notre
temps en deux pôles, celui de la légèreté qui n'est pas
forcément superficialité et peut inclure l'humour et la
distanciation et celui de la pesanteur, lequel ne se confond pas
forcément avec la lourdeur. Alain Finkielkraut établit cette
distinction et se range lui-même du côté de la pesanteur.
S'adressant à Peter Sloterdijk, il écrit : « Votre Essai
d'intoxication volontaire
m'a ouvert les yeux en m'obligeant à me situer dans cette "guerre
mondiale invisible et incomprise dont l'enjeu est le poids du monde
: la guerre du léger contre le lourd". Vous avez mis des mots
sur mon malaise. J'ai compris en vous lisant que, face à la volonté
de rendre la vie toujours plus légère, flexible et
tourbillonnante, j'appartenais
au camp de la pesanteur et du fil à la patte.
Poursuivant votre réflexion, il m'arrive même de penser que nous
avons subrepticement changé d'élément : la navigation
sur le Net, la liquéfaction
des choses par les images, le flottement
de
toutes les valeurs, la dissolution
cool
des rigidités séculaires, tout cela me donne l'impression d'être
un Terrien égaré dans le monde de la béatitude
aquatique ».
Richard Millet, nous y reviendrons plus tard, appartient lui aussi,
au camp
de la pesanteur,
il est dépourvu d'humour.
Le
camp des frivoles.
Il y a aussi le camp des frivoles,
ceux qui vivent le monde comme un éternel camp de vacances du Club
Med. Mais il faut établir une distinction entre la légèreté et
la frivolité.
Le
camp des Adeptes du New Age,
qui fuit illusoirement le monde, cette Vallée de Larmes et
privilégient le développement
personnel,
une forme de narcissisme qui fait appel à des techniques
« spirituelles » ou à une pseudo spiritualité à la
carte. On peut parler, avec Gilbert Durand, de secte
à propos de ce camp-là !
Le
camp des Belles-Âmes,
qui répercutent et amplifient le discours impérialiste mille fois
entendu de la bien-pensance,
des bons
sentiments,
du misérabilisme
et de la culpabilisation
généralisée.
Le prêt-à-porter de la « pensée de gauche », au sens
large et approximatif du terme, laquelle prend parfois, en effet,
des accents misérabilistes, donneurs de leçon, inquisiteurs et
ostraciseurs professionnels. Dans ce camp, on trouve de nombreux
artistes, des personnes du show-biz, des journalistes, des
représentants des médias, des opportunistes, des démagogues, des
demi-habiles.
Le
camp des paranoïaques.
À
ce camp, appartiennent ceux qui tombent sans cesse dans le discours
de l'indignation justicière, de la plainte et du ressentiment. Ils
sont généralement tristes, pessimistes, dépourvus d'humour et
désespérés. Ils voient des complots et des ennemis partout,
contre la culture et contre l'École.
Les tentatives de catégorisation
ont leur limite, comme toutes les catégorisations, et c'est ainsi
qu'existent des traits communs entre les représentants de ce camp et
ceux du précédent. Des recoupements existent entre les différents
camps et l'on peut appartenir en même temps à plusieurs camps !
Le
camp des nostalgiques.
Encore une fois les catégorisations ont leur limite et certaines
personnes que l'on serait tenté de ranger dans la catégorie des
nostalgiques, ne se vivent pas comme des nostalgiques. Le désespoir
de ceux qui appartiennent à ce camp est différent, plus
nostalgique, plus passéiste sans doute, mais surtout plus profond
et essentiel. C'est un désespoir
ontologique, différent
de la simple dépression, il atteint le noyau de l'être et est
communicatif. La lecture de Richard Millet est déprimante ! Ils
sont généralement dotés d'une solide culture philosophique,
possèdent une grande lucidité et un grand esprit de sérieux. Ils
sont du côté de la pesanteur
!
Ce
sont des humanistes à tout crin, croyant à l'impossibilité de
l'établissement d'un néo-humanisme ou d'un humanisme postmoderne.
Ceux appartenant au camp des Belles Âmes
les nomment parfois en un raccourci injuste les « nouveaux
réactionnaires ». Ils souffrent, face à l'état de
déliquescence, de médiocrité et de vulgarité de notre société.
Dans ce camp, on trouve des hommes comme Richard Millet qui nous
expose ses
arguments d'un désespoir contemporain,
nous
parle de son aversion
pour le monde contemporain
et de sa radicale solitude.
Alain
Finkielkraut appartient aussi sans doute à cette famille, il ne
laisse rien passer, reste droit dans ses bottes. C'est un spectateur
engagé
au regard exigeant et intransigeant, qui ne recule pas d'un pouce
face aux discours ambiants et à la mode. Son attitude ne manque pas
de grandeur, même si l'on n'est pas tenu de partager son avis sur
tous les sujets : la question de l'éducation ou la question juive,
notamment, et même si on peut considérer qu'elle manque
singulièrement d'humour, « un moyen (…) de s'adapter à
l'irréversible, de rendre la vie plus
légère
et plus
coulante ».
Les
dynamiques qui président au fonctionnement des membres de ces divers
camps s'alimentent mutuellement, celui que nous avons appelé le camp
des nostalgiques emprunte certaines de ses idées aux discours des
paranoïaques et ses idées naissent en réaction contre les idées
véhiculées par les Belles Âmes.
Le
camp des « religieux »,
qui puisent des raisons de croire, d'espérer et de vivre dans
l'héritage ancestral des religions institutionnalisées. Richard
Millet est héritier de la tradition catholique, mais estime que les
représentants actuels du catholicisme trahissent cet héritage
auquel il croit encore. Le film iranien La
séparation
met en scène de façon magistrale les mécanismes mentaux du
religieux et ses conséquences psychologiques et morales
destructrices.
Le
camp des réenchanteurs.
Entre ces divers camps, il doit bien exister un espace
interstitiel,
le camp de ceux qui ne se laissent pas gagner par le désespoir
ambiant, mais qui possèdent en eux une force
vitale,
qui les fait supporter et accepter le monde de manière
tragique,
sans se polariser de manière obsessionnelle sur les traumatismes
subis, sans tomber dans le désespoir, l'indignation justicière
(François Flahault), la dénonciation, l'anathème, l'esprit de
croisade, la crainte d'être mal aimés, le ressentiment, parfois,
en un mot la souffrance
qui, si elle possède bien des raison d'être, ne saurait constituer
la position finale et la mieux adaptée à la situation
anthropologique actuelle. Dans ce camp, on peut situer François
Roustang, Carl Rogers, C.G. Jung, Michel Maffesoli, Henry Miller et,
surtout, Peter Sloterdjik, lequel possède la force et la culture
philosophique nécessaire pour faire face aux sentiments de
désespoir, dont s'accompagne le regard lucide porté sur notre
situation contemporaine. Ce sont des hommes dont la pensée peut
nous aider à « reformuler une théorie du courage »
à une époque qui semble bien se caractériser par le déclin
du courage.
On
peut contester ce choix et penser que tous ces hommes ne méritent
pas de figurer dans cette liste des « réenchanteurs »,
on peut critiquer certaines de leur posture, mais ces hommes semblent
avoir en commun une
force,
laquelle ne s'accompagne pas forcément d'une attitude éthique
irréprochable, une force qui leur permet de contrebalancer l'ennui,
le désespoir et la dépression ambiante.
Leur
réflexion nous invite à rompre avec la représentation
anthropologique propre à la Modernité et à changer radicalement
nos modes de représentation et à
changer nos vies de
fond en comble, à larguer sans crainte les amarres, à faire un saut
(dans le vide ?).
S'il
convient, naturellement, d'éviter de retomber dans le dualisme dont
souffre notre société occidentale, il semble que nous puissions,
malgré tout, suivant en cela la manière de penser de Peter
Sloterdjik, distinguer deux types d'attitudes radicalement distinctes
face à la vie et face au monde actuel. Il y a ceux qui sont engagés
dans « une entreprise de démantèlement progressif du
narcissisme anthropologique », qu'il appelle aussi « les
grands maîtres de la recherche vexatoire », ces hommes qui
participent au désenchantement du monde, et ceux qui, au contraire,
tentent de contribuer, à leur mesure, à son réenchantement.
L'attitude
des enchanteurs. Les
enchanteurs
ne
sont pas ceux qui célèbrent benoîtement le monde et feignent
l'admiration pour ne pas tomber dans le désespoir. Ce ne sont pas,
non plus, ceux qui crient haut et fort leur volonté d'être des
enchanteurs, en prétendant qu'ils détiennent les solutions au
désenchantement actuel.
Ce
sont plutôt ceux qui acceptent,
sur le mode tragique, le monde et la vie, tels qu'il nous est donné
de les vivre et sans les parer de vertus imaginaires, inventées pour
conjurer magiquement leur peur de vivre tout simplement la banalité
et la grandeur mêlées des jours. Les véritables enchanteurs, ce
sont ceux qui tiennent
bon,
tiennent
tête
et « étonnent la catastrophe par le peu de peur qu'elle fait
naître en eux », ainsi que l'écrivait Victor Hugo, cité par
Cynthia Fleury.
Ils gardent leur sourire
vainqueur, même
dans les moments de défaite provisoire, une jovialité
souveraine,
une légèreté
que la gravité de la vie n'entame pas. Ils évitent la plainte qui
renforce les causes qui l'ont fait naître, au lieu de les éloigner.
Plutôt que de se plaindre et incessamment porter plainte – les
deux attitudes allant souvent de pair, comme le montre François
Roustang – plutôt que de gronder, ils rient ou sourient d'un
sourire vainqueur ou, tout au moins, amusé, et que rien ne semble
pouvoir entamer. Ils
ne
cessent de se mettre en marche ou, pour parler comme les mystiques,
ils vont de
commencement en commencement,
c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de renoncer au savoir que leur
réflexion et la vie leur avaient permis d'accumuler. Ils
n'appartiennent pas à
la société de consommation,
mais plutôt à celle de la consumation
(M. Maffesoli). La consumation s'accompagne de cendres, mais des
cendres naît à nouveau le feu, une nouvelle inspiration, un nouvel
élan. Comme l'oiseau Phénix, les enchanteurs renaissent sans cesse
de leurs cendres. Le courage dont ils font preuve n'a pas de fin, ni
de buts précis, il n'est pas déterminé à l'avance, il est
incessante adaptation, ouverture au moment présent, ainsi qu'aux
nécessités « morales » que chaque moment fait naître.
Leurs actes précèdent toute décision morale, ils ne sont en rien
la conséquence logique et obligée d'un système de valeurs
cherchant à s'imposer aux autres comme une norme universelle. Leur
morale – peut-être conviendrait-il mieux de parler d'attitude
éthique
ou de création
morale ? –
est
adaptation,
invention
et création,
et non application mécanique d'une loi surplombante qui s'imposerait
de manière transcendante. Comme l'écrit Cynthia Fleury, « La
création morale n'est
pas une paternité définitive ».
En
tant que système de valeurs éternelles
et de normes à appliquer sans nuance, la
morale traditionnelle, que l'on pourrait dire « moderne »,
est
près du dictat, du dogme, de l'idéologie et du moralisme. C'est une
morale qui, semble-t-il, est en train de mourir, comme est en train
de mourir une certaine image du père, chargé d'incarner la loi de
façon transcendante, à la manière d'un dieu qui édicte à
l'adresse des autres des principes et des préceptes, sans être
lui-même tenu de s'y conformer.
Comme
l'écrit Vladimir Jankélévitch, cité par Cynthia Fleury, « en
morale, ce qui est fait reste à faire », la vie est
expérimentation et création permanentes. On retrouve ici la
dimension
initiatique,
sur laquelle nous avons déjà attiré l'attention du lecteur,
parlant
d'un retour du désir initiatique,
lequel ne s'impose pas à la manière d'une obligation morale, mais
comme une nécessité intérieure ou archétypique, tant sur le plan
individuel que sur le plan collectif.
Le
courage n'est pas une vertu morale, mais un lien existe entre courage
et vitalité, ainsi que nous le montre Cynthia Fleury. C'est ce lien
qu'il conviendrait de rendre vivant, plutôt que de décréter
l'obligation morale de faire preuve de courage. Ce qu'il nous
faudrait retrouver, c'est la vitalité, l'amor
fati
et l'amor
sciendi,
le savoir n'étant plus synonyme de pouvoir, mais de puissance et de
force nous poussant à être fidèle à notre vocation, sans aucune
idée de mérite ou de hiérarchie, en postulant qu'une certaine
complémentarité existe entre toutes les vocations, aussi humbles et
limitées, soient-elles.
La
volonté et le courage doivent être impérativement convoqués,
lorsque le désir et la vitalité ont été entamés par des épreuves
trop lourdes à porter, lorsque le « bouclier narcissique »
a été définitivement entamé, lorsque nous avons perdu confiance
en la vie et perdu de vue l'intérêt que nous avons à être
pleinement nous-mêmes, non à la façon narcissique des adeptes du
New-Age
et sans tenir compte de la question d'une possible amélioration du
monde et de revitalisation des liens sociaux. Le
défi qui nous
est lancé, est, non pas tu
dois changer la vie,
mais tu
dois changer ta vie,
au
lieu de sans cesse t'en remettre à l'État
et aux institutions et de tomber dans le discours de la plainte, du
ressentiment et du devoir que la société aurait envers toi, obligée
qu'elle serait d'assurer ta réussite et ton bonheur. Si, comme on
peut le penser, une capillarité existe entre tous les destins
individuels pleinement assumés, chaque destin individuel contribue à
tisser un destin collectif par voie de rayonnement et d'échange
réciproque. Les véritables enchanteurs sont les artisans d'une
nouvelle
forme de socialité
plus fraternelle et capable de répondre à l'appauvrissement des
liens sociaux et au refuge grandissant dans la sphère individuelle.
Contact
Jean-Daniel
ROHART
51100 Reims
jeandanielrohart@hotmail.com
|

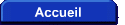



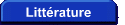






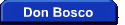



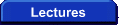
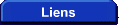
 Quel camp
choisir ?
Quel camp
choisir ?