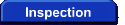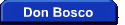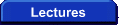|
|
 Hans,
Ana et Juan-Carlos
Hans,
Ana et Juan-Carlos

|
|
|
« Car
dès qu'on était dans les Iles, on sentait bien qu'il y a quelque
chose à trouver ».
Alexandre Vialatte.
Depuis
qu'il avait mis fin à son activité lucrative, il avait vieilli d'un
bond, et il n'arrêtait pas de lire, addiction qui l'obligea à
emménager provisoirement dans un F4 et à acheter sur plan une
future suite ininterrompue. Le fait d'avoir exercé sa vie durant le
métier d'accélérateur des initiatives de clients dont l'enfance
avait été plus triste encore que la sienne, au point de tarir à
jamais en eux la source de toute forme d'imagination, n'avait pas
contribué à le rendre inventif pour ce qui était des initiatives
qui le concernaient en propre, lui et les personnes qu'il pensait lui
être le plus proches.
Ne
trouvant pas le monde qu'il habitait et les congénères qu'il
croisait dans les rues et dans les parcs, à la hauteur de ses rêves,
il partit à la recherche d'un livre qui décrirait le monde dont il
n'avait jamais cessé de rêver. Il était toujours déçu et
insatisfait, les diverses interprétations de La
jeune-fille et la mort
le laissaient toujours sur sa faim d'idéal. Ce qu'il aurait vraiment
aimé rencontrer, c'est un livre qui, au lieu de se complaire dans la
description redondante du quotidien, l'eût totalement ridiculisé,
au point de rendre inéluctable la naissance d'un autre monde qui
serait venu remplacer celui qui, à force d'être moqué et
ridiculisé, se serait retiré honteux sur la pointe des pieds
penauds. Le seul livre qu'il prenait un certain plaisir à lire,
c'était celui qu'il s'était vu contraint d'écrire, face à
l'impossibilité où il était de trouver un livre correspondant
vraiment à ses attentes, car là il était à peu près parvenu à
dépeindre un univers plus ou moins poétique et drôle, dans lequel
il se reconnaissait vaguement et où il aurait vraisemblablement été
heureux de vivre. Son personnage préféré, l'homme qu'il aimait le
mieux, c'était celui qu'il avait inventé à partir d'une assez
bonne connaissance de lui-même, de ses réactions et de ses
aspirations, non qu'il le jugeât parfait ni même exemplaire, mais
au moins Hans semblait-il être parvenu à créer un couple
harmonieux avec lui-même et il savait qu'il était incapable de lui
faire le moindre mal. Il savait comment se comporter avec Hans pour
ne pas lui déplaire et l'agacer et, en plus, ce Hans était un chic
type prêt à s'apitoyer sur le sort de ceux qu'il sentait encore
moins bien lotis que lui et à entendre le récit de n'importe quelle
vie, sans s'émouvoir inutilement, au nom de la morale ou des
sentiments vains. La plupart des romans actuels qui lui tombaient
sous la main avide décrivaient complaisamment un réel qui ne lui
semblait pas mériter un tel honneur.
On dirait que les lecteurs qu'enthousiasment de tels romans ont
conscience du caractère piteux et misérable de leur propre vie et
se réjouissent, faute de mieux, de voir que leur quotidien banal,
insignifiant et vide, est également celui de nombreux autres et
qu'il peut même être, malgré tout, érigé en œuvre d'art
communément admirée, la fonction de l'art étant alors à peu près
celle d'une thérapie
de soutien.
La littérature vaut alors, en effet, pour ses vertus thérapeutiques
et apaisantes, sa fonction est de rassurer l'homme moderne angoissé
et qui n'est plus très sûr de rien et de le soulager
de sa difficulté d'être.
Étant
d'une lecture facile, ce genre de littérature peut même lui faire
croire qu'il est intelligent et qu'il a un goût littéraire sûr,
dont est garant le succès incontesté de ces livres aimés de tous,
et que la vie est simple et vaut d'être vécue, à condition de
cesser de se poser de vaines questions et d'en attendre trop. Les
textes qui obéissent à une telle logique médicale agissent à la
manière d'une anesthésie locale ou d'un anti-dépresseur, ils ne
nous font pas aimer la vie, ils se contentent d'en gommer les
aspérités, les souffrances et les incertitudes. On y respire un
calme rassérénant. À l'image de la vie de qui n'est pas atteint
d'une maladie grave, n'a pas de dettes impossibles à rembourser, et
des enfants qui ont des notes correctes au collège et obtiendront
vraisemblablement le baccalauréat avec une mention, ces livres ne
suscitent ni l'admiration, ni la passion, la désapprobation ou le
dégoût. Ils reflètent une sagesse faite d'acceptation et de refus
de toute exigence démesurée.
On
dirait, se dit Hans à lui-même, qu'après une journée de travail,
il ne reste plus aux lecteurs harassés assez de force, de courage et
d'imagination pour imaginer une autre vie que celle qu'ils sont en
train de vivre jour après jour, une vie qu'ils ont le plaisir
étrange de retrouver au détail près, dans des romans populaires et
qui finit par acquérir à leurs propres yeux fatigués un caractère
inéluctable. Le reflet de notre vie dans le miroir de cette
littérature de hall de gares et de correspondances de Métro,
apparaît plus beau et lumineux que l'original qui l'a nourrie, notre
vie est sinon magnifiée par la poésie et la magie des mots, au
moins rendue supportable par le fait qu'elle est partagée par
presque tous nos voisins de palier et les usagers du Métro et du
R.E.R., et qu'elle nourrit des œuvres célèbres. Sur la ronéo de
la littérature en vogue, notre vie banale est multipliée à
l'infini, un vulgaire concert s'élève dans les airs médiatiques,
l'évocation minutieuse de nos vies individuelles toutes semblables,
acquiert la dimension d'une prosaïque épopée, l'épopée des
éclopés de la vie qui se mettent à lire en chœur la triste
partition de leurs jours ordinaires, dont ils ont confié la
composition à un écrivain public assermenté pour cela.
Lorsque
Ana Gavalda remplace Juan-Carlos Onetti, la littérature se fait complice
de la dépoétisation du mode, soupira Hans. Le fourgon de voyageurs
tous en train de lire Ana
et Camille
avait vraiment de quoi donner la nausée. Hans descendit à la
station suivante et préféra continuer son chemin à pied,
accompagné de ses amis Juan-Carlos, Louis-Ferdinand, Alexandre2,
Ramón3,
Pedro4
et João5.
Jean-Daniel Rohart.
_______________________________________________
|
 Le
grand style
Le
grand style

|
|
|
On
peut parler de grand
style,
lorsque ce qui se révèle à nous possède un caractère d'évidence,
comme si les mots qui se détachent sur la page, au fil de la lecture,
avaient toujours été là, exactement là, présents à la virgule
près, agencés dans ce même ordre, comme de toute éternité. Par
l'acte de la lecture, et avec la complicité de l'auteur, le lecteur
prend mieux conscience de son existence et de ses propres
potentialités, il a le sentiment de faire émerger d'un prétendu
néant, des mots et des phrases qui en fait étaient déjà là
présents depuis l'aube des temps, il se réapproprie et invente le
monde. L'histoire que racontent les mots n'a au fond qu'assez peu
d'importance, c'est l'aura dont ils sont entourés, c'est
l'atmosphère qu'ils contribuent à faire naître qui compte,
s'impose et reste gravée dans la mémoire, longtemps après qu'on ait
refermé le livre. Comme dans les grands rêves et les grands films,
le temps engouffre les détails anecdotiques, la trame romanesque se
distend, s'effrite, s'érode, mais on garde indélébiles, dans notre
souvenir, une impression générale et nette, une scène, un moment,
un rythme, une pulsation, une tonalité, le plaisir que nous avions
pris lors de la toute première projection. Les projections qui
suivent sur l'écran de notre mémoire s'échelonnent au cours du
temps, elles effacent les détails, les omettent, et les renvoient
dans l'oubli, mais elles conservent pour toujours l'essentiel. Ce qui
reste gravé en nous, c'est le reflet plus ou moins vif et prégnant,
de l'Au-delà que tel film, tel livre, tel morceau de musique a un
instant fait surgir en nous pour notre édification. L'homme
sans passé, Parle avec elle, Dersou
Ouzala,
La Comédie de Dieu
de João Cesar Monteiro, appartiennent à cette catégorie d'œuvres
que l'on peut dire inspirées,
ces œuvres qui nous redonnent confiance en la vie, nous replace au
sein du Cosmos, parce qu'elles sont porteuses d'une voix qui semble
venir d'ailleurs.
La
vie brève,
ainsi que toutes les nouvelles de Juan-Carlos Onetti et les romans de
Marcel Proust, appartiennent à ces mêmes œuvres qui rendent un
culte à la Réalité mystérieuse dont nous devinons la présence.
Ces œuvres inspirées sont comme des trouées, des flash
plus ou moins poétiques, forts et vigoureux qui, passagèrement,
déchirent la nuit, son angoisse et ses doutes, nous révélant une
Réalité dont nous sommes depuis toujours nostalgiques, parce que
habités par la Sehnsucht
des
romantiques allemands. La certitude chevillée au plus profond de
nous, qu'une autre réalité existe au-delà de celle qui tisse et
informe notre quotidien plus ou moins morne et désespérant, a
besoin d'être réaffermie de temps en temps, par les moments de
grâce que l'Art véritable nous offre. Les véritables créateurs
sont les porteurs d'une mission pour ainsi dire sacrée, par leur
travail ils aident à l'épiphanie d'un monde secret, lointain et
poétique, au lieu que la plupart des littérateurs actuels,
prisonniers du narcissisme, sont les démarcheurs sans scrupules du
monde insipide et sans âme qui pourrit notre vie, la vide de son
sens et nous fait désespérer même du Sens que nous croyions un
instant avoir entrevu.
Jean-Daniel Rohart.

Contact
Jean-Daniel ROHART
51100 Reims
jeandanielrohart@hotmail.com
|
|