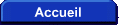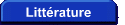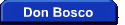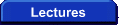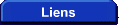|
(Créativité
psychologique et naissance
de l’Âme)

Jean-Daniel
Rohart - Livre inédit à ce jour
« En fait, il semble bien que le
développement de la conscience requière un ancrage très solide dans la
réalité : une personnalité incarnée dans le quotidien… ». Commentaire de James HILLMAN au livre de
Gopi KRISHNA intitulé : Kundalinî. Autobiographie d’un éveil.

EPILOGUE
 Le Processus d’individuation : transformation
ou différenciation et approfondissement ? Le Processus d’individuation : transformation
ou différenciation et approfondissement ?
« L’incomplétude,
décidément, est au cœur de l’opération. Rien en effet n’est plus étranger (…) à
la psychologie analytique inaugurée
par Jung que le rêve d’une intégration
accomplie » Christian
Gaillard
Au terme de cette “ analyse ”,
reflet de lectures peut-être parfois mal “ digérées ”, au terme d’une
expérience intérieure en partie vécue et en partie fantasmée sans doute, ce que
l’on peut dire, sans préjuger en rien de ce qu’est l’expérience mystique, c’est
que, malgré l’existence d’apparents recoupements, une différence radicale
semble finalement la séparer de l’expérience, plus “ naturelle ”,
humaine et accessible, que l’on peut faire du processus d’individuation.
Ce processus, tel que Jung tente d’en
rendre compte par approximations successives, est, selon lui, un processus
vital et naturel, à la fois objectivement repérable et tout à fait mystérieux,
un processus dont le travail analytique (et la vie de tous les jours !) ne
peut que favoriser le développement, en l’accompagnant pas à pas. C’est, nous
dit aussi Jung, une tendance spontanée de l’inconscient dont on peut, au mieux,
ne pas contrarier ou perturber le cours : c’est “ une loi naturelle,
que la conscience peut percevoir ou ne pas percevoir ”.
Un fossé semble donc séparer l’homme
individué ou engagé sur la voie de l’individuation et le
“ saint ” !, l’individuation pouvant être définie comme le lent
et difficile accomplissement d’un destin personnel chez un homme qui vit
simplement la vie qu’il a à vivre,
en évitant de son mieux toutes les formes d’idolâtrie, y compris celles qui
consistent à idolâtrer l’inconscient et à hypertrophier son rôle par rapport à
celui du conscient, et à idolâtrer aussi autocomplaisamment sa propre quête et
son “ développement ” personnel.
Cet accomplissement le plus complet
possible d’une vie n’a rien à voir avec le génie, ni avec un quelconque idéal
de perfection ou de “ sainteté ” : “ avant d’aspirer à la
perfection, nous devrions être en mesure de vivre la vie des gens ordinaires sans laisser dépérir notre être
propre ” écrit Jung . (in Correspondance 1958-1961, page 84). Mais
le problème est que : “ le contact avec la grandeur nous menace
toujours d’inflation ” ! (Jung Op. cit. page 90). Aussi le risque est-il grand d’identifier
le moi et le Soi, et de planer dangereusement sur les hauteurs supposément
atteintes un court instant, au mépris du caractère forcément persistant de
notre Ombre, ainsi qu’au mépris de notre simple humanité.
Car, ainsi que l’expliquait Jung dans une
lettre adressée au Père Lucas :
“ Au cours de ce processus, il y a, par éclair, (des) moments de
libération ”, et, apparemment, aussi de joie et d’euphorie. Mais, il nous
faut craindre de tels moments, conseillait Jung à ce même correspondant, car
“ dans ces instants là (nous rejetons) la charge de la condition humaine
(qui) va (nous) retomber dessus deux fois plus lourdement. ”
Ce que l’on vise, au contraire, à travers
tout ce travail d’individuation, c’est la plus grande simplicité possible. Ce
dont il s’agit, c’est non pas se confondre imprudemment avec le Soi, mais, au
contraire, l’accepter et se soumettre à lui, lorsque l’on pense en avoir fait
l’expérience, à moins que le recours à la théorie du Soi ne soit en fait une
simple “ prothèse ” pour tenter de combler un vide, un manque, une
blessure profonde et encore ignorée ou maintenue à distance par un effort
“ théorique ” destiné à la conjurer, l’étouffer, la taire malgré les
signes (symptômes) d’impatience qu’elle nous donne parfois.
L’individuation et l’intégration ne
requièrent pas “ les qualités d’un saint (ou) une supériorité sur les
autres hommes ” ! Elle requiert seulement une forme de Sagesse faite
de simplicité et d’acceptation.
Etre “ individué ” - si tant
est que l’on puisse l’être !-, c’est, en effet, accepter le destin, l’aimer, alors que “ le Puer tente, dans
une grande envolée extatique d’(y) échapper ”Ainsi s’expliquent, par cette grande envolée extatique, les “ exagérations
spirituelles ” et “ l’ambition spirituelle ” dans lesquelles
nous tombons parfois. Ce que Etty HILLESUM appelle “ la gloutonnerie
spirituelle ”.
Cette tendance à s’élever vers les
sommets, sur les pas imprudents d’Icare – l’archétype d’Icare – participe
vraisemblablement du désir d’occultation de sa propre Ombre et de l’oubli de
ses limites humaines. Elle est refus du banal et du quotidien, refus de prendre
en compte patiemment notre histoire personnelle et notre fonctionnement propre,
un dégagement vers le haut, une envolée qui est aussi fuite dangereuse. Selon
James HILLMAN, “ il y a probablement davantage de psychopathologie latente
dans le fait de vouloir s’élever au-dessus que dans le fait d’être immergé dans
la pathologisation ”.
S’engager dans le Processus
d’Individuation, ce n’est pas, en dernière “ analyse ”, voler au-dessus du quotidien, et du
banal (ce que HILLMAN appelle “ la Vallée ”) ce n’est pas échapper au
sort du commun des mortels, c’est plutôt – dans la mesure où notre souci de
l’âme est contagieux pour autrui, ainsi que pour le monde, – remythologiser ce
monde, le re-poétiser, le “ guérir ” en lui faisant retrouver son
Ame, c’est aussi retrouver le lien qui nous unit à autrui et à sa souffrance,
sœur de la nôtre, au lieu de se polariser, de manière plus ou moins infantile,
narcissique et auto-complaisante, sur l’idée d’une guérison totale ou sur celle
d’un développement personnel continu, d’une perfection postulée dans une
logique ascensionnelle, quantitative et cumulative, qui ne nous ancre pas dans
le moment présent, mais nous projette vers un avenir supposément meilleur ou
même idéal ou parfait.
La façon qu’ont, au contraire, les jeunes
actuels de vivre immergés dans le moment présent, de s’“ éclater ”
sans se préoccuper de changer le monde, peut aussi être interprétée comme un
retour du refoulé venant compenser ce qu’avait d’unilatéral et d’illusoire –
une illusion paranoïde – la volonté des générations précédentes influencées par
l’“ esprit ” de Mai 68, son messianisme et sa nébuleuse
“ new-âge ”, de s’élever au-dessus de cette Vallée de larmes par le
biais de la spiritualité ou de l’action “ révolutionnaire ” qui
visait à changer le monde de façon prométhéenne, prétentieuse et volontariste
et à tenter d’instaurer le Paradis sur
terre, au nom de grands principes surplombants, principes moraux,
philosophiques, politiques et dogmatiques, des principes que l’on pourrait dire
théologiques.
Pour clarifier les choses, on peut
distinguer, avec James HILLMAN, deux conceptions de l’accomplissement. On peut
parler de deux visions de
l’individuation.
La première, inspirée du monothéisme
culturel ambiant, dans sa version théologique et psychologique, (ces deux
dimensions étant étroitement liées) met l’accent sur la transformation, le
progrès indéfini et constant, sur l’accession, par étapes successives et
hiérarchisées, au plan
prétendument “ supérieur ” de l’Unité : le Soi, l’archétype
privilégié par JUNG, l’Imago Dei
(cette vision du Soi semble posséder une vertu rassurante face au risque d’un
possible éclatement du moi acceptant de se confronter au multiple).
La deuxième manière d’envisager
l’individuation, d’essence polythéiste, met l’accent sur le multiple auquel
elle accorde une valeur égale à celle de l’Unité. Elle nous convie à accepter
(peut-être au milieu de l’angoisse !) nos propres démons, tous nos démons
dans leur multiplicité chatoyante, multiplicité constitutive de l’âme et de
l’expérience humaine, à nous affronter, à nous débattre avec eux, elle nous convie
à assumer la part normale d’ “ anormalité ”, l’infirmitas de
l’archétype, au lieu d’essayer d’en finir à tout prix avec des symptômes jugés
comme gênants et devant être éradiqués à l’aide de processus thérapeutiques
souvent longs et coûteux et se substituant de façon trop systématique à la vie
elle-même.
Si, comme le dit JUNG, les symptômes
névrotiques sont le langage actuel des dieux réclamant leur dû et cherchant à
s’incarner en nous, il semblerait sage de laisser s’exprimer librement leurs
voix, faits et gestes, en nous, plutôt que de nous raidir contre eux et contre
leurs aspects anormaux et monstrueux (on pense ici à la “ critique ”
jungiennne d’une figure du christ et de Dieu débarrassée de tout Mal, de tout
aspect ombreux, de toute anormalité et de toute monstruosité, ainsi qu’au livre
de D.H. LAWRENCE, L’homme qui était mort, où le romancier développe une critique
du christianisme proche de celle de JUNG.
Plutôt que de chercher à incessamment se
transformer et à s’ “ améliorer ”, guidé par une conception
linéaire du temps et par le souci et la perspective plus ou moins paranoïde,
d’atteindre à un plan plus élevé et idéal (les cimes que HILLMAN oppose aux
Vallées), il semble s’agir plutôt pour celui qui vit le Processus
d’Individuation de la deuxième manière, d’approfondir ce qui se trouve être
déjà normalement en lui, dans un état d’inachèvement et de confusion plus ou
moins grand, ce qui revient, pour le dire autrement, à réaliser son Ame, toutes
les potentialités de l’Âme, et ce, dans un effort de différenciation,
d’élaboration, de particularisation, de complication, tous ces termes étant
utilisés par J. HILLMAN pour définir le travail alors accompli.
Le monde moderne, prométhéen, tourne le dos à cette réalisation de l’âme, qui
nécessite un travail individuel, dans la mesure où il valorise la dimension
collective, le changement social et la notion de progrès, un progrès prétendument constant et infini.
Au fond, on pourrait dire pour conclure
ici le récit du travail intérieur accompli au cours de ces quinze dernières
années, que le livre qui en est sorti semble décrire et refléter une
métamorphose, une rupture, le passage de la première à la deuxième manière
d’envisager et de tenter d’incarner l’individuation. S’il est vrai que
“ les mythes peuvent changer au cours d’une vie ”, ainsi que l’écrit
J. HILLMAN, et que l’âme peut “ à son propre rythme servir de nombreux
dieux ”, ce livre marquerait une “ apostasie ”, une transition,
une ouverture à l’adoration ou au service d’autres “ dieux ”
jusqu’alors ignorés.
On peut y voir se réaliser le passage
d’une conception du Processus d’Individuation strictement (dévotement !)
“ jungienne ” ou prétendue telle et “ protestante ”, dans
la mesure où Jung a “ concentré principalement son attention sur la
phénoménologie du Soi ”, à une conception largement inspirée de J. HILLMAN
et de sa psychologie polythéiste ou archétypale, dans un souci de mise à
distance du substrat judéo-chrétien, monothéiste, réducteur et aliénant.
Au terme de ce livre semble s’amorcer le
deuil d’un certain christianisme, d’une certaine conception
“ protestante ” et monothéiste de la religion et de la psychologie,
pour s’ouvrir à la richesse jusqu’alors ignorée de la mythologie polythéiste
grecque.
Autre vertu possible de ce travail :
m’avoir débarrassé d’une conception “ théologique ” - emprunte
d’esprit de sérieux et d’un manque certain d’humour
– de la psychologie et de ce que J. HILLMAN appelle l’idéologie du Salut, présente dans la manière actuelle que nous
avons d’envisager la thérapie.
La théologisation de la Psyché
s’accompagne d’une psychologisation de Dieu, ce qui pourrait expliquer les
rapports difficiles que JUNG a toujours entretenus avec les théologiens.
HILLMAN, quant à lui, fait l’hypothèse que le travail théorique effectué par
JUNG aurait sauvé, au moins provisoirement, le christianisme (le mythe
chrétien) de la remise en cause plus radicale dont il était menacé.
Pour HILLMAN, en tout cas, l’enjeu est
capital. Pour lui, il s’agit de rien moins que de “ libérer ” les
figures divines de l’âme, anima et animus, du dogme de la domination du Soi
(P. 60)
Enfin, plus simplement, ce travail m’aura
sans doute aidé à descendre des cimes (peut-être me fallait-il préalablement
donner son dû à Icare, au risque d’y succomber, l’archétype d’Icare possédant
une part d’infirmitas, comme tous les archétypes) pour retrouver simplement les
joies, les plaisirs, les tourments, l’angoisse et les peines de la Vallée,
ainsi que la dimension de l’altérité, l’ouverture sur autrui me faisant
échapper à une centration trop exclusive sur le moi et à une complaisance
envers ma propre quête que j’ai longtemps idolâtrée.

Table des matières
INTRODUCTION
ET AVERTISSEMENT AU LECTEUR
I.
LA DEMARCHE JUNGIENNE : LE PROCESSUS D’INDIVIDUATION : CONFIANCE ET
FRATERNITE
Introduction : traditions et
créativité
·
Le
processus d’individuation : confiance et fraternité
· Processus
d’individuation et christianisme
·
Processus d’individuation et Amour (n°1)
: l’Eros
jungien
· Processus d’individuation et Amour (n°2)
: l’Eros
hessien
·
La thérapie
comme “ idéologie du salut ” : ou la fraternité : une nouvelle
utopie ?
· La
“ guérison ” ou l’évangélisation des profondeurs ?
II.
CREATIVITE PSYCHOLOGIQUE ET REMYTHOLOGISATION DU MONDE
Introduction : La créativité psychologique : un
postulat initial
·
Dialoguer
aussi
avec les figures de l’excès. Dionysos : énergie
psychique et créativité
archétypique
· Créativité
psychologique et théorisation de son propre cas
· Le travail
analytique (jungien ?) : une érotique. La rencontre d’Eros et de
Psyché
· Deux
conceptions de l’image du Père. Vers une image « jungienne » du
Père ?
· Psyché et l’Ame
du Monde. Remythologiser le Monde
· Harmoniser les
figures du masculin et du féminin
· Les défis à
relever par l’homme occidental. Monothéisme ou polythéisme ?
· Fin du règne de
la libido de parenté ? Une nouvelle fraternité ? Ou : la
revanche de l’Ame sur l’esprit
III.
L’ACTION EDUCATIVE ET LA QUETE DU SENS
· L’analyse
jungienne : fondement et aliment d’une quête
· L’arrière plan jungien et “ chrétien ” de nos
recherches personnelles et de notre attitude en classe
· Une
démarche essentiellement empirique et expérimentale :
a)
La classe
comme entité “ thérapeutique ” et formatrice
b) “ Faire son deuil ” de
l’analyse ou : de la classe comme entité “ thérapeutique ” à la
classe “ taoïste ”
· L’anthropologie jungienne et ses prolongements éthiques
et éducatifs. Ou l’archétype comme clef de voûte d’une renaissance
“ sociale ” et “ culturelle ”
Introduction : anthropologie jungienne et
“ New-Age ”
a) L’action éducative et la dimension de l’archétype
Archétype du Puer Aeternus et éducation
Archétype du Père et éducation
-
l’action éducative et la question du Père
-
la question de l’inspection et son arrière-plan
archétypique : l’inspecteur : un “ père ” ou un pair ?
-
une nouvelle image de père : Don Bosco et les salésiens
de Don Bosco : vers une pédagogie post-moderne
b) Processus
d’individuation, action éducative et lutte contre la névrose
c) Action
éducative et éthique : vers “ une morale régénérée ”.
Ou : une éthique archétypique et “ naturelle ”
Jung et le problème du mal
Courage et lucidité
Une confiance indéfectible
Une nouvelle éthique de l’action enseignante
d) L’éthique
et le problème du mal
e) L’action
éducative comme “ exercice ” (spirituel). Contribution à une éthique
jungienne de l’éducation
f) Action éducative et “ guérison ”
g) De
commencement en commencement ou : Action éducative et / ou thérapeutique
et Processus d’individuation
h) Processus
d’individuation et “ chemin du sorcier ”
Conclusion : l’impossible objet
de la recherche
IV. VERS UNE NOUVELLE PSYCHOPEDAGOGIE : L’ACTION
EDUCATIVE ET LES ETAPES DE LA MATURITE
· Une société
“ adolescentrique ” : “ l’homme moyen de la société industrielle n’est pas un adulte ”
· Education
moderne et immaturité
· Qu’est-ce
que la maturité ? Première approche
·
“ La
maturité n’a jamais été le but fondamental de notre éducation ”
· Le manque
de maturité des responsables
· Qu’est-ce
que la maturité ? Jung et “ le processus d’individuation ”
· L’action
éducative comme facteur de maturation. Vers une “ formation ”
incluant le plan de l’être
Conclusion : la maturité comme idéal,
le plan de l’être et de l’Agapè
V. VERS UNE ANTHROPOLOGIE TERNAIRE OU : NECESSITE
D’UNE NOUVELLE “ PHILOSOPHIE ” DE L’EDUCATION
Introduction : absence actuelle
d’une véritable philosophie de l’éducation
· Et “ Le lycée pour le XXIème
siècle ” d’Allègre ?
· Il n’y a pas de crise de l’Ecole
·
La question du sens
· La dimension de l’archétype
·
La crise de notre société ? Une crise des
“ valeurs ” paternelles ou de l’archétype du père surmoïque
·
Philosophie de l’éducation et altérité
· Philosophie de l’éducation et notion de personne
·
Philosophie de l’éducation et empathie
·
Philosophie de l’éducation et vocation
· Philosophie de l’éducation et prophétisme : vers
une anthropologie tripartite
VI. PLAIDOYER POUR L’ESPRIT (DE TOLERANCE) ou : LA
DIMENSION SEXUEE DE LA RELATION EDUCATIVE
· Relation éducative et dimension sexuée
· Toute action éducative vraie comporte une part de
risques : le Mal et l'Ombre
· Malaise enseignant, absence de sens de la pratique
enseignante et recherche de boucs émissaires
· Tenir bon sur l’éthique
· Action éducative, équipes pédagogiques et régulation
des affects
· “ Sécuriser sans enfermer ” et
“ frustrer sans semer l’angoisse ” : une tâche
délicate
·
L’éducation, l’Occident et le dualisme
· Dialogue dialectique et dialogue dialogal
VII.
L’ECRITURE, L’ACTION EDUCATIVE ET LA QUESTION DU SENS
Introduction :
question du sens et langage
· Processus d’individuation, quête du sens et émergence
du Soi
· Névrose, vocation personnelle, expérience du Soi,
expérience de "Dieu"
· Processus d’individuation et expérience mystique
· Spécificité de la voie “ mystique ” jungienne
· Processus d’individuation et littérature C.G. Jung.
D.H. Lawrence : acteurs et témoins du processus d’individuation
·
Poésie et Processus d’individuation
· Enseignement des langues et culture : esquisse d’une
conception jungienne de la culture
VIII.
CONCLUSION : CONFIANCE ET FINITUDE : PREMISSES ET FONDEMENTS DE
L’HARMONIE
EPILOGUE :
le Processus d’individuation : transformation ou différenciation et
approfondissement ?
Jean-Daniel ROHART
51100 Reims
jeandanielrohart@hotmail.com
|